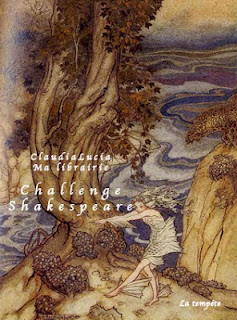|
| Chagall : La Baie des Anges |
La dame de la mer est une des pièces d’Ibsen paru en 1888 qui est de loin l'une des plus optimistes des pièces de Henrik Ibsen.
L'intrigue
 |
| Jean-Francis Auburtin : Sirènes |
Le docteur Wangel, un homme bon et sincère, a deux filles, Bolette et Hilde, de sa première épouse. Veuf, il se remarie avec Ellida, une jeune femme étrange qui vit mal son implantation au bord d'un Fjord, trop loin de la mer dont elle n’a jamais été éloignée jusqu’alors. Elle a besoin de cet élément pour vivre d’où son surnom La dame de la mer. La pièce commence avec l’arrivée d’Arnholm, ancien professeur de Bolette qui revient la voir, elle et sa famille, après des années d’absence. Il y a aussi la présence d’un jeune artiste malade, Lyngstrand, dont les bavardages parfois importuns vont apporter des éléments nouveaux à l’action.
Ellida se confie d’abord à Arnholm qui est son ami, puis à son mari. Peu à peu l’on apprend que la dame de la mer est marquée par le souvenir du passé et d’un homme à qui elle a été promise. Il l’a quittée, après avoir commis un crime, en s’embarquant sur un navire non sans lui avoir fait jurer de l’attendre. Il a scellé ce serment en jetant leurs bagues à la mer. Cet homme a appris son mariage et Ellida sait qu’il reviendra la chercher pour l’amener. L’aime-t-elle? Non, semble-t-il, car elle se sent très attachée à son mari Wangel malgré la différence d’âge. Pourquoi cet aventurier de la mer exerce-t-il alors sur elle une telle fascination? S’agit-il d’une fatalité à laquelle elle ne pourrait échapper? Est-elle vraiment libre?
Une femme venue de la mer : le Folklore scandinave
 |
| Mairmaid : Waterhouse |
Cette femme venue de la mer et ce mariage symbolique qui placent la nature au centre la pièce nous plongent au coeur des vieilles légendes nordiques. Telle une banshee des légendes celtiques ou une sirène à queue de poisson du folklore scandinave, Ellida semble sortie de la mer pour épouser un homme de la Terre. La mer possède une telle une attraction qu’il semble inutile de vouloir lui résister. Ellida se sent marquée par la fatalité et quand elle se confie à son mari c’est pour recevoir son aide. Mais elle reste persuadée qu’elle ne saura pas résister à l’homme qui va venir l’enlever à son mari. C’est ce qui a permis d’interpréter la pièce d’Ibsen comme une exploration de la folie; de quelle maladie mentale souffre cette femme affligée, quelle névrose la ronge? Les critiques de l’époque, rejetant l'interprétation issue de la légende, ont pensé qu’elle était sous influence hypnotique (l’hypnose est très à la mode à cette époque), comme envoûtée par cet homme qui possède une pouvoir anormal sur elle.
Une femme privée de liberté
 |
| La dame de la mer entre son mari Wangel et le marin mise en scène Claude Baqué (Paris Les bouffes du Nord 2012) |
Mais une autre explication psychologique me paraît très intéressante. Ellida n’a jamais été libre de penser et d’agir par elle-même, il y a d’abord eu son père, gardien de phare, puis ce marin auréolé de mystère qu’elle a cru aimer, puis son mari. Quand elle a épousé le docteur Wangel à la mort de son père, elle était seule, sans ressources, elle n’avait pas d’autre choix. L’attachement est venu après, grâce à la bonté et l’amour de son mari. Pour moi, Ellida est une soeur de la Nora de La maison de poupées. C’est le sort des femmes, en général, au XIX siècle. La loi les maintient sous tutelle, elles restent d’éternelles mineures, doivent obéissance à leur mari. La fatalité qui pèse sur Ellida n’en est pas une, c’est surtout l’incapacité de choisir, l’impossibilité de dire non, l’ignorance de son moi profond. Il n’est pas étonnant donc que les mots d’amour de Wangel la libèrent quand il lui donne le choix, lui dit qu’elle est libre, qu’elle seule peut décider. Une interprétation réaliste, donc, d'un thème cher à Ibsen, une revendication en faveur des femmes que l’on retrouve aussi avec le personnage de Bolette.
Un relatif optimisme
 |
| Bolette et le professeur Arnholm : Source |
C’est la première fois que je rencontre chez Ibsen autant de personnages positifs, sincères et désintéressés. Ellida est une victime et une femme attachante, intéressante. Le docteur Wangel sait s’oublier soi-même pour aider son épouse. Il n’est pas sans faiblesse. Il néglige ses filles en faveur de sa toute jeune femme même s’il les aime profondément. Mais il est prêt à sacrifier son bonheur pour sauver Ellida.
Bolette et Hilde Wangel sont des jeunes filles charmantes, intelligentes et elles ont du caractère. Quant à Arnholm, l’amour qu’il éprouve pour Bolette, est si sincère qu’il se montre grand et généreux envers elle. Lui aussi donne la liberté du choix à la jeune fille.
Une belle pièce et qui pour une fois se termine bien! On comprend que la diversité des interprétations entre romantisme, symbolisme, réalisme, soit un vrai bonheur pour les metteurs en scène!
Ellida. — Écoute, Wangel, il est inutile, à l’heure qu’il est, de nous mentir.
Wangel. — Nous nous sommes donc menti, jusqu’à présent ?
E. — Oui. Ou, du moins, nous nous
sommes dissimulé la vérité. La vérité, la vérité pure et sans fard,
c’est que tu es venu là-bas m’acheter…
W. — T’acheter ! Tu dis que je t’ai… achetée !
E. — Oh ! je ne me fais pas meilleure que toi. J’ai consenti. Je me suis vendue.
W, la regardant douloureusement. — Ellida, as-tu vraiment le coeur de parler ainsi ?
E. — De quel nom veux-tu donc que j’appelle ce qui s’est passé ? La solitude te pesait, tu as cherché une autre femme.
W. — J’ai cherché une seconde mère pour les enfants, Ellida.
E. — Oui, par surcroît. Peut-être.
Et, encore, tu ne pouvais pas savoir si je convenais à ce rôle. Tu
m’avais vue. Tu m’avais parlé deux ou trois fois. C’est tout. Je te
plaisais, et alors…
W. — Bien, appelle cela comme tu voudras.
E. — De mon côté j’étais seule, sans
ressources, sans soutien. Rien d’étonnant à ce que j’aie accepté
l’offre que tu m’as faite d’assurer mon avenir.
W. — Ce n’est vraiment pas ainsi que
j’ai envisagé la question, chère Ellida. Il ne s’agissait pas d’assurer
ton avenir, il s’agissait, je te l’ai loyalement déclaré, de partager
avec les enfants et moi le peu que je possède.
E. — Oui, tu me l’as déclaré. Et
moi, j’aurais dû dire non ! Jamais, à aucun prix, je n’aurais dû me
vendre! Plutôt le travail le plus humble, les conditions les plus
misérables, librement acceptées, librement choisies !