Pour le challenge du roman naturaliste en Europe, j’ai choisi de lire un écrivain allemand très connu en Allemagne et beaucoup moins en France, Theodore Fontane. C'est ce que déplore Claude David dans la préface du livre édité chez Robert Laffont. Ce volume présente quatre romans de cet auteur dont celui que j’ai lu, Frau Jenny Treibel paru en1892.
Effectivement je ne connaissais pas Fontane et même pas de nom ! Claude David explique que l'écrivain appartient à une famille huguenote française qui chercha refuge en Allemagne après la révocation de l’Edit de Nantes et qui forme à Berlin une « colonie » restée unie au XIX siècle. Son oeuvre romanesque, dix-sept romans, commencée à l’âge de soixante ans s’achève lorsqu’il en a presque quatre-vingts en 1898.
J’ai eu du mal à saisir toutes les allusions qui concernent les particularités historiques et les idées politiques d’une Allemagne divisée qui commence à s’unifier après la victoire de 1870 sur les Français à Sedan. Par exemple, est-ce que Fontane critique les Hambourgeois parce qu'il est contre l'unification? On nous dit qu’il est prussien et berlinois de coeur. Or, il ne cesse de critiquer la rigidité des Hambourgeois, l’éducation conventionnelle et étouffante qu’ils donnent aux filles, leur affectation, leur snobisme vis à vis des anglais à qui ils veulent ressembler : « So english ! ».
Le récit
 |
| Theodor Fontan |
Nous sommes à Berlin dans les années 1885 après la destitution de Bismarck. L’énorme indemnité payée par la France après la défaite de Sedan et les territoires annexés apportent richesse et puissance aux Allemands, amenant au pouvoir une classe bourgeoisie souvent inculte, matérialiste, mais riche, comme la décrit Fontane dans Frau Jenny Treibel.
Jenny Triebel, fille de boutiquier, a épousé un riche conseiller commercial, Triebel, fabricant de produits chimiques, qui se lance dans la politique. Madame a désormais cinquante ans et deux fils : Otto qui travaille dans le commerce du bois et qu’elle a marié à une riche Hambourgeoise Héléna, et Léopold, un « gamin » de 25 ans, entièrement soumis à sa maman et qu’elle entend bien marier selon son choix.
Face à eux, une autre famille, Willibald Schmidt, universitaire et sa fille Corinna. Autour de ces derniers gravite « le groupe de sept sages », société constituée de professeurs qui se réunissent pour des échanges intellectuels et partager un bon repas. Marcel, un jeune professeur d’archéologie, amoureux de sa cousine Corinna, est soutenu par le père de la jeune fille.
Or l’intelligente, fantasque et spirituelle Corinna a décidé d’épouser Léopold Triebel malgré la volonté de sa mère Jenny, et bien qu’elle considère le jeune homme comme un gentil benêt; elle n’a, d’ailleurs, pas plus de considération pour la famille Triebel. Elle veut sortir de sa classe sociale pour accéder aux plaisirs que donne la richesse et va tout faire pour séduire Léopold.
Il y a aussi la « chère Schmolke », la servante des Schmidt, avec son franc parler. Cette dernière représente le peuple dans le roman et bénéficie de la sympathie de l’auteur. Elle aime Corinna qu’elle a connue enfant à la mort de la mère et a une vision très juste de la société.
Une vision sociale
L’intrigue est légère et tient en peu de mots : Corinne épousera-t-elle Léopold ou non ? Mais l’intérêt est ailleurs, dans la vision de la société et la critique en règle de la bourgeoisie, classe sociale que n’aime pas Fontane et dont il parle avec ironie. L’auteur oppose ici une classe sociale instruite, les professeurs, Schmidt et ses amis, qui, malgré leurs défauts, vanité, pédanterie et chicaneries, incarnent la culture et le savoir, et une classe moyenne, propriétaire, en train de se doter d’une immense richesse mais qui est inculte et sotte et tâche d’augmenter son pouvoir par les alliances et la politique, les Treibel. Le fameux repas que donne la famille chez eux, suivi d'un concert, est une véritable scène de comédie qui souligne les ridicules de chacun !
Treibel, monsieur le conseiller commercial, n’est pas un méchant homme mais il est conservateur et a «la bourgeoisie dans le sang», c’est dire qu’il est imbu de sa classe sociale mais aussi de lui-même.
« Treibel, ordinairement nerveux lorsque quelqu’un parlait longtemps, ce qu’il n’autorisait, mais dans ce cas avec une grande générosité, qu’à lui-même… »
Jenny Triebel, est une femme qui se persuade qu’elle est très sensible et aimante. Elle se plaît à dire qu’elle aime la poésie qu’elle confond avec romantisme et sensiblerie. Mais elle est en réalité une femme au coeur sec, qui ne s’intéresse, en fait, qu’à l’argent et au pouvoir. Jeune fille, elle s’est fiancée avec Willibard Schmidt. Celui-ci, très amoureux d’elle, comme elle aime à le rappeler, lui écrivait des poèmes. Mais elle le laisse tomber pour épouser le conseiller général Triebel. Le professeur s'en est consolé, mais il ne se fait plus d'illusion sur elle. Jenny est le personnage qui, avec, Héléna, la Hambourgeoise, est la moins sympathique de tous et que Fontane épargne le moins.
"C’est une personne dangereuse, et d’autant plus dangereuse qu’elle ne le sait pas elle-même; elle s’imagine sincèrement avoir un coeur sensible et surtout ouvert « au choses les plus hautes ». En réalité ce coeur n’est accessible qu'au tangible, à tout ce qui a du poids, qui rapporte des intérêts et elle ne cédera Léopold que contre au moins un demi-million, d’où qu’il vienne. "
Willibard Schmidt, juge, le plus souvent, avec légèreté les gens qui l’entourent, il est d’une grande indulgence envers sa fille et n’intervient pas dans ses caprices. Il attend, au contraire que le bon sens reprenne le dessus, et admire Corinna pour son indépendance et son émancipation. Il pense qu’elle reviendra d’elle-même à la raison, tablant sur son intelligence, sa sincérité. L'éducation qu'il donne à sa fille est en avance sur son temps et fait de Corinna, une jeune fille "moderne". Il adopte sur tout une attitude détachée qui ne va pas de sa part sans un certain égoïsme. Rien ne le touche profondément, tout au moins à l’âge qu’il a atteint. Mais quel humour ! Il résume la situation ainsi : « On peut à la rigueur entrer dans une famille ducale, mais pas dans une famille bourgeoise. » Quant à Rosalie Schmolke, la servante, elle représente le bon sens populaire et dit à propos de l’hypocrisie de Frau Jenny Triebel, "elle a toujours la larme à l’oeil mais c’est des larmes qui ne coulent pas, elles veulent pas descendre ".
J’ai beaucoup aimé la finesse psychologique des personnages et la complexité des caractères qui s’expriment essentiellement dans le discours. Les personnages de Fontane sont des bavards et possèdent le don de la parole.
Naturalisme ?
Fontane dit de lui-même que sa plus grande qualité est de ne pas chercher à changer la nature humaine. Effectivement, le regard qu’il porte sur ses semblables est sans illusion mais jamais vraiment amer ou violent. On dirait parfois qu’il se tient à distance de ce qu’il observe, un peu comme un entomologue, avec curiosité, et un certain détachement souriant et léger. On voit qu'il ne s'agit pas d'un naturalisme à la Zola. Le réalisme de Fontan est élégant. Il occulte le plus souvent les détails crus, la misère, la sexualité, le crime, même quand il parle du peuple pour lequel il éprouve de la sympathie. C'est pourquoi l'on a pu parler à son propos de "réalisme poétique".
Il y a pourtant un beau passage qui aborde le sujet de la prostitution mais toujours avec délicatesse quand le mari de Schmolke, à présent décédé, chargé de la police des moeurs, s'aperçoit que sa femme est jalouse des prostituées et lui explique dans le langage du peuple ce qu'éprouve tout homme qui a du coeur : " Il sent ses cheveux se dresser sur la tête devant toute cette misère, tout ce malheur et, quand il en arrive certaines qui sont par ailleurs mortes de faim, ça arrive aussi, et nous savons que les parents sont à la maison à se tourmenter nuit et jour à cause de cette honte, parce que cette pauvre créature qui est souvent arrivée là d'une drôle de manière, ils l'aiment quand même, ils voudraient l'aider, lui porter secours, si aide et secours sont encore possibles, et bien, je te le dis Rosalie, quand il faut voir ça tous les jours, quand on a un coeur, quand on a servi dans le premier régiment de la Garde, quand on est pour l'honnêteté, la tenue, la santé, les histoires de séduction et tout ça, ça passe et on voudrait sortir et pleurer."








.jpg)

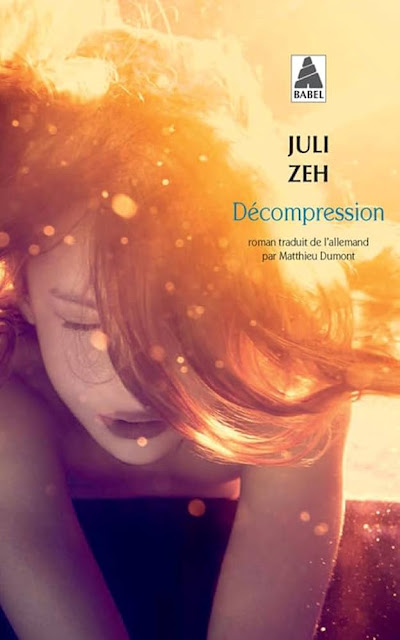




















.jpeg)

