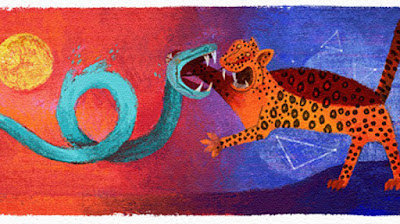Dans Les enquêtes de monsieur Proust par Pierre-Yves Leprince, il est question d’un carnet perdu qu’il faut retrouver absolument, d’un drame de la jalousie, d’apparitions fantomatiques dans le jardin de Versailles, du meurtre d’un employé dans le grand hôtel situé près du palais de Versailles où Marcel Proust s’est installé en attendant son aménagement à Paris.
Peut-on dire alors qu’il s’agit d’un livre policier ? La réponse est non, même si Marcel Proust, sans presque sortir de sa chambre, aide à résoudre ces énigmes. Non, car c’est avant tout le livre d’un grand amoureux de Proust qui connaît parfaitement le personnage et qui parle de lui avec ferveur et admiration, ce qui n’exclut pas un portrait entier de l’écrivain avec ses grandeurs et ses petitesses.
Mais c’est aussi un roman et nous sommes donc dans une fiction. Le narrateur, Noël, est un vieillard qui écrit ses souvenirs de jeunesse et évoque sa rencontre avec Marcel Proust à la fin de l’année 1906.
Noël a 17 ans. Il est si petit qu’il semble être un enfant de 13 ans, aux bonnes joues rouges. Il travaille comme coursier pour un cabinet d’enquêteurs. Il fait la connaissance de Marcel Proust en retrouvant son carnet perdu et Proust est frappé par l’intelligence du jeune homme. Commence alors une amitié entre Noël, enfant naturel, issu d’un milieu très modeste, et le riche bourgeois, homme du monde, qui n’est pas encore un écrivain connu. Ils se sentent des affinités communes, ils sont tous deux « enquêteurs », et se rapprochent grâce à la musique que Proust aime, qu’elle soit savante ou populaire comme celle de Charpentier.
Monsieur Proust, un riche homme du monde
Une amitié qui ne va pas sans heurts et difficultés mais où, pourtant, Marcel Proust révèle une sensibilité et une ouverture aux autres pleine de délicatesse. C’est avec tact qu’il fait l’éducation de l’enfant, l’invitant à sa table, lui enseignant la façon de se tenir, corrigeant son langage, comblant ses lacunes culturelles, discutant avec lui sur un plan d’égalité. J’ai beaucoup aimé cet aspect « Pygmalion » qui fait ressortir la personnalité des deux personnages, l’un réel, l’autre fictif.
Ce qui ne l’empêche pas d’agir en grand seigneur plein de charme, certes, mais un Monsieur devant qui tout le monde plie, le personnel de l’hôtel, Noël, succombant à ses exigences mais aussi à ses caprices, ses phobies, ses crises.
Car Proust est un être affaibli par sa maladie, l’asthme, il ne peut se déplacer que rarement et revient épuisé de ses promenades, il a toujours froid et garde son manteau jusque dans sa chambre, il mange très peu, et ne peut respirer que dans une atmosphère saturée d’incessantes fumigations. La perte récente de sa mère, le plonge dans une profonde dépression. Il n’est pas toujours aisé de le satisfaire. Oui, bien sûr, on sait tout cela mais Pierre-Yves Leprince donne vie à son personnage en décrivant sa fragilité physique et psychique et sa force intellectuelle. Proust est en train d’écrire ce qui deviendra Du côté de chez Swann. Il agit, par rapport aux autres et par rapport à sa quête du temps et de la mémoire comme un véritable enquêteur, observant directement les faits - ou par l’intermédiaire de ceux qui le servent-, émettant des hypothèses, les vérifiant, s'appuyant aussi sur sa connaissance de la nature humaine.
Je crois pouvoir dire que, nous fréquentant et nous observant sans cesse, jetant des ponts au-dessus des différences de fortune et de classe, il nous connaissait, nous, les petits, mieux qu’aucun des hommes de son monde. Pour un lecteur d’aujourd’hui les barrières sociales font partie de l’Histoire, la portée universelle de La Recherche met sur le même plan la servante et la duchesse, toutes deux soumises aux lois de leur milieu et de leur temps, c’est le miracle et le charme du livre »
L’oeuvre de Marcel Proust a quelque chose de magique qu’elle doit au pouvoir des mots, à la phrase qui fait entendre la voix de celui qui écrit, au rythme complexe et savant. Mais il mène sa recherche du temps perdu avec rigueur et méthode :
Marcel Proust était le contraire d’un illusionniste, il était un homme de science, un savant dans un laboratoire, un photographe qui cherche le meilleur liquide révélateur pour tirer la meilleure épreuve possible des réalités qu’il a enfermées dans son appareil. La magie de celui qui nous parlait était son pouvoir de transformer de simples mots en images vivantes… »
Noël, un personnage du peuple
 |
| Enfants au travail en usine |
Ce que j’ai apprécié aussi dans ce livre, c’est que le personnage romanesque, Noël, a du caractère, une personnalité. Il n’est pas seulement un faire valoir de Proust. Il existe en tant que représentant d’une classe sociale pauvre et exploitée. Le narrateur vieillissant se livre d’ailleurs à une analyse de la société du début du XX siècle et montre que le déterminisme social n’était jamais remis en cause à cette époque et était encore plus implacable que maintenant.
Mais Noël existe aussi comme individu ayant reçu une belle éducation populaire, son grand père lui raconte la Révolution française, Victor Hugo, et lui fait aimer la devise française, Liberté, égalité, fraternité, il lui fait donner des cours de musique par un de ses amis, qui n’est autre que Charpentier ; sa mère lui enseigne l’honnêteté, la politesse sans bassesse, elle le pousse à s’émanciper, à saisir sa chance par le travail. Les joutes oratoires entre le garçon et le maître sont amusantes car si l’élève raisonne bien, il fait des fautes de grammaire et l’apprentissage de la négation devient un moyen pour l’enfant de marquer subtilement, soit sa bonne volonté, soit sa désapprobation. Le jeune homme refuse de se laisser humilier même par quelqu’un qu’il admire et qu’il aime. Il y a une scène très belle qui éclaire, à la fois, le caractère de Proust et celui de Noël. Marcel Proust souffre, aussi bien en amitié qu’en amour, d’une jalousie féroce, ce qui déclenche une crise violente au cours de laquelle il insulte son jeune ami. La réponse de Noël est une leçon de dignité que l’écrivain accepte humblement (mais pas trop !) en reconnaissant ses torts..
Enfin, Noël, en tant que fils du peuple travaillant dès son plus jeune âge, dans une société qui ne protège pas les enfants, a déjà eu à subir des propositions d’hommes plus âgés, qu’il toujours refusées. S’il se méfie, au début, de l’amitié de Marcel Proust, celle-ci sera sans équivoque, même si le thème de l’homosexualité, comme dans La Recherche, est très présent dans ce roman.
Comme dans le recherche du temps perdu tout était affaire de « côtés ». De l’un on parlait avec horreur de « moeurs antiphysiques », de l’autre on les pratiquait sans scrupules. Si elles avaient lieu entre adultes consentants, elles étaient permises par la loi ; si elles avaient lieu entre personnes de la même classe sociale, elles étaient difficiles ; si elles étaient entre de classes sociales différentes, l’argent faisait taire la réprobation; la familiarité n’abaissait pas les barrières mais donnait l’occasion de les franchir….
Analyse qui permet au narrateur -âgé de près d’un siècle lorsqu'il rédige ses mémoires- d’établir des comparaisons entre le passé et le présent sans y trouver toujours une nette amélioration !
On achetait faveur et silence, les barrières sociales étaient franchies, celle des âges et des lois aussi, le gamin payé se taisait, c’était "tout simple" (certains de nos contemporains retrouvent ce "tout simple" dans des pays pauvres, comme le fit Gide en Algérie à la fin du XIX siècle, certains autres dans nos grandes villes, en payant de jeunes immigrés venus de ces mêmes pays, c’est "tout simple").
A mes yeux, les enquêtes sont presque anecdotiques si ce n'est qu'elles permettent de révéler comment fonctionne Marcel Proust, ses méthodes de raisonnement. Elles permettent aussi de relier deux personnages trop dissemblables pour se rencontrer autrement. L'intérêt est donc ailleurs !
Ce roman a le mérite de faire revivre l'un des plus grands écrivains français et d’être, loin de la biographie, un vrai roman avec des personnages fictifs qui ont une existence, avec une vision de la société d’alors et de maintenant. Ce qui fait qu’il peut intéresser non seulement les amoureux de Proust mais les autres. S’il y a quelques longueurs dans le texte, elles sont vite oubliées et la lecture en est agréable et intéressante.