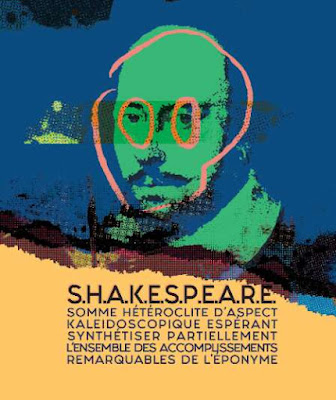Will le magnifique de Stephen Greenblatt est un livre à ne pas manquer pour tous les amoureux de Shakespeare mais pour les autres aussi car le livre est un puits de science à la fois sur la vie et l’oeuvre du dramaturge mais aussi sur l’histoire anglaise du XVI siècle, sous le règne d’Elizabeth 1er et de Jacques 1er.
Stephen Greenblatt part du constat que l’on connaît peu la vie du personnage ( pas de lettres alors qu’il était séparé de sa famille restée à Stratford quand il vivait à Londres, pas de journal intime, pas de mémoires écrits par ses contemporains ) mais d’abondants documents rendant compte de sa vie officielle, acquisitions de propriétés, recettes des théâtres, certificats de mariage, de baptême, procès, testament et puis… bien sûr, il y a ces œuvres ! Et si justement celles-ci rendaient compte de sa vie, révélaient ses pensées secrètes, ses sentiments, ses idées, bref ! Et si la biographie du grand dramaturge pouvait se lire à travers et par ses écrits ? C’est ce que va étudier Greenblatt et c’est ce qui rend cette étude si passionnante.
Enfin et pour une fois un biographe, Stephen Greenblatt, qui ne remet pas en cause la paternité des œuvres de Shakespeare mais qui, au contraire, met en lumière pourquoi elle est incontestable. Non qu’il veuille aborder cette question d’ailleurs. Son intérêt est ailleurs. Il part de ce postulat :
« L’une des caractéristiques fondamentales de l’art de Shakespeare est de ne jamais se couper du réel. Shakespeare est un poète qui remarque que le lièvre traqué est « tout trempé de sueur » ou que l’acteur victime d’opprobre peut se comparer à la main indélébilement tachée du teinturier. »
William Shakespeare est né en 1564 et est mort en 1616. Il est l’aîné des enfants de John Shakespeare et de Mary Arden et a certainement fait ses études de l’âge de sept ans à 13 ans à la Grammar school de sa ville natale Stratford-upon-Avon. Des études entièrement dispensées en latin et consacrées à l’étude de textes religieux mais aussi d’auteurs latins, comme Plaute ou Terence. Les troupes itinérantes qui s’arrêtaient à Stratford ont pu aussi lui donner le goût du théâtre. Mais il n’a pu aller à l’université car son père - qui était gantier et bailli de la ville - ruiné, n’avait plus la fortune nécessaire pour l’y envoyer. Quand il arrive à Londres pour y exercer le métier d’acteur et se mettre à écrire Shakespeare doit se faire un nom. Il fréquente alors le cercle des écrivains et dramaturges, souvent de mauvais garçons, buveurs, ripailleurs, mais aussi espions, voleurs, qui tournent autour du théâtre dont Marlowe, son plus grand rival avant sa mort violente dans une rixe. Le théâtre a cette époque est plus que jamais un commerce et la concurrence y est rude, il faut gagner la protection d’un haut personnage pour survivre et les épidémies de peste qui ferment tous les lieux de loisir plongent souvent la plupart des troupes dans la misère. Ces poètes sont tous diplômés d’Oxford et de Cambridge forment une caste qui ne doit rien à la fortune ou à la noblesse mais bien au prestige de leurs études. Ils regardent de haut tous ceux qui ne sortent pas de l’université. Ils forment un cercle fermé et snob et sont rapidement jaloux des succès de Will. L’un d’eux, vraisemblablement Robert Greene, traite Shakespeare ainsi :
« Oui, méfier-vous d’eux : Car il en est un parmi eux, un Corbeau parvenu qui s’embellit de nos plumes, et qui, dissimulant son coeur de tigre sous la peau d’un comédien, s’imagine qu’il est tout aussi capable que le meilleur d’entre vous de grandiloquer des vers blancs et en véritable Johannes-à- tout- faire, il se considère vaniteusement comme l’unique Shakescene (ébranleur de scène) du royaume. »
Et c’est le même snobisme qui, de nos jours, refuse de reconnaître Shakespeare comme l’auteur de ses œuvres, et pour les mêmes raisons ! Sous prétexte qu’il n’est pas sorti de l’université, qu’il est issu du peuple, ses détracteurs attribuent ses textes à un aristocrate, un universitaire, comme si un autodidacte doté d’une mémoire excellente, d’un don aiguisé de l’observation et d’une grande imagination ne pouvait être capable de faire oeuvre de génie, comme si un acteur qui doit incarner toutes les classes sociales, ne pouvait pas s’identifier à un aristocrate.
« Il convient d’invoquer le pouvoir d’une imagination incomparablement puissante, un don qui ne dépend pas du fait qu’on a, ou non, mené une vie prétenduement intéressante. De longues et fructueuses études ont démontré comment l’imagination de Shakespeare métamorphose ses sources, car dans la majorité de ses œuvres, il emprunte de matériaux qui circulent déjà et les transforme par la puissance de son énergie créatrice. »
L’érudition, certes Shakespeare peut l’acquérir par ses lectures ( j’ai noté qu’il lisait Montaigne, entre autres !). Mais pour le reste il puise dans le réel, dans ce qu’il a pu observer, dans les traditions populaires, les coutumes solidement ancrées dans la vie campagnarde. Celle-ci est peinte dans son oeuvre, non comme une pastorale destinée à plaire à la haute société, mais avec des détails vrais. Shakespeare connaît parfaitement les travaux des champs. Son père était fils de métayer et achetait de la laine directement au producteur pour la traiter. Il décrit les conditions de vie du berger, le cycle de saisons, la vie des animaux, les noms des herbes et des fleurs.. La nature est souvent présente dans ses pièces et donne lieu à de très beaux passages lyriques tout en témoignant d’une connaissance intime du monde rural.
« Le théâtre doit participer à la fois de cette envolée visionnaire de l’imagination et d’un enracinement dans le quotidien, ce quotidien qui constitue une partie intégrante de son imagination créatrice. Shakespeare ne devait jamais oublier le monde quotidien et provincial dont il était issu …. »
On sait peu de choses des années qui ont précédé l’arrivée de Shakespeare à Londres. On pense qu’il a peut-être travaillé comme gantier avec son père et le biographe note l’abondance des références relatives à ce métier du cuir dans ses pièces.
« Romeo aimerait être le gant qui recouvre la main de Juliette, afin de pouvoir lui effleurer la joue. Dans Le Conte d’Hiver le colporteur transporte dans sa musette « des gants comme roses parfumées » ? Le parchemin n’est-il pas en peau de mouton ? se demande Hamlet. « si Monseigneur et aussi de veau. » lui répond son ami Horatio.. Dans La comédie des erreurs, quant à l’officier, engoncé dans son uniforme du cuir, Shakespeare le compare à « une basse de viole dans un étui de cuir ». ( etc…) En créant le monde enchanté du Songe d’une nuit d’été, Shakespeare s’amuse même à miniaturiser l’art du cuir : la « chatoyante » peau abandonnée par le serpent qui mue est assez large pour un manteau de fée et « l’aile de cuir » des chauves-souris pour celui des elfes.
Peut-être a-t-il aussi travaillé dans une étude d’un notaire car il il a le vocabulaire d’un juriste et plus tard il se révélera très compétent pour gérer ses biens, acquérir des propriétés et se doter d’une solide fortune. Il a certainement commencé sa carrière théâtrale comme acteur avant de se rendre à Londres.
Tout en éclairant la vie de Shakespeare par son oeuvre, Greenblatt brosse un tableau de la Renaissance anglaise, ce XVI Siècle dominé par la royale figure d’Elizabeth puis Jacques 1er, un siècle tourmenté, où règne la discorde entre catholiques et anglicans et dans lequel l’héritage religieux de Henri VIII a fait de la reine le chef de l’église anglicane. Les grandes familles catholiques complotent dans l’ombre et lorsque le pape s’en mêle et excommunie la souveraine, la peur du complot, la suspicion, les rumeurs d’assassinat, font peser une chape de plomb sur la société. Beaucoup de nobles perdent la vie, leur tête exposée sur une pique à l’entrée du pont de Londres. Les puritains qui vont encore plus loin dans la répression que la reine, attaquent le théâtre qu’ils accusent de tous les vices, et sont aussi une force délétère qui ajoute encore à ce climat de peur et de tension.
Entre une mère catholique et un père qui de par ses fonctions publiques affiche son adhésion à l'église anglicane mais est peut-être resté secrètement catholique, on comprend que William Shakespeare se soit montré discret sur sa vie privée. De même qu’il devait se montrer habile dans ses pièces pour ne pas heurter l’orgueil des nobles et des souverains surtout quand il peignait leur règne et leurs moeurs. Et ce d’autant plus qu’il vit dans un société hiérarchisée à outrance, les hommes dominent les femmes, les personnages âgées les plus jeunes, les classes sociales sont extrêmement marquées et la naissance dans l’une d’elles crée un déterminisme dont il est malaisé de s’échapper. Les supérieurs attendent respect et exigent de recevoir des marques de déférence dues à leur rang, l’acteur et le dramaturge n’étant pas beaucoup plus qu’un serviteur chargé de les divertir et ne bénéficiant pas même de l’impunité du Fou du roi. Un siècle inquiétant et pourtant riche au niveau culturel où le théâtre acquiert peu à peu et parfois difficilement ses lettres de noblesse. Un grand plaisir de lecture !


.jpg)