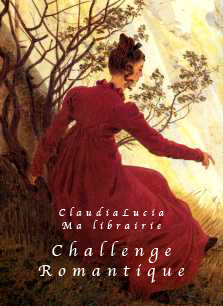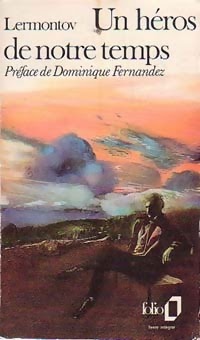Mikhaïl Lermontov
Écrivain et poète russe (Moscou 1814 – Piatigorsk, Caucase, 1841).
Orphelin de mère, il est élevé dans la propriété
de sa grand-mère, qui le tient éloigné de son père. Il entre en 1827 à
la Pension noble de Moscou, où il s'enthousiasme avec ses condisciples
pour la poésie du jeune Pouchkine, celle des poètes décabristes et les
idéaux qui l'inspirent. Il écrit ses premiers poèmes,
les Tcherkesses et
le Prisonnier du Caucase (vers 1828). Lorsque Nicolas I
er
ferme cette institution trop libérale en 1830, il poursuit ses études à
l'Université, d'où il est exclu en raison de ses prises de position
contre certains professeurs conservateurs. En 1832, il entre dans les
hussards de la garde. Il continue cependant d'écrire, travaille au
Démon et termine
Hadji Abrek (1833). Affecté comme officier à Tsarskoïe Selo, il découvre la vie mondaine, qui lui inspire la pièce
Un bal masqué (1835) et un roman inachevé,
la Princesse Ligovskaïa (1836). Il réagit à la mort de Pouchkine par des vers violents contre son meurtrier (
la Mort du poète, 1837), ce qui lui vaut d'être envoyé au Caucase comme simple soldat. Mais son poème l'introduit à la direction du
Contemporain, journal de Pouchkine, où il publie un poème,
Borodino (1837). Le Caucase exerce sur son caractère et sur son œuvre une influence énorme. Il revient à Saint-Pétersbourg, termine son
Démon (1841), collabore à la revue
les Annales de la patrie, où paraissent des récits qui entreront dans
Un héros de notre temps (
Bella, Taman, le Fataliste,
1939), et fréquente le milieu littéraire et les salons. Il reste
cependant un esprit frondeur et, à la suite d'un duel avec le fils de
l'ambassadeur de France, il est arrêté et à nouveau exilé, cette fois
avec exclusion de la garde et à un endroit dangereux du Caucase, alors
que
Un héros de notre temps (1839-40) est publié et obtient un
grand succès. Il prend part à des combats sanglants, qu'il décrit dans
ses poèmes. En 1840 paraît un recueil de ses vers, pour lequel il n'a
retenu qu'un petit nombre de poèmes. Un duel, provoqué par une querelle
avec son camarade Martynov dans des conditions assez obscures, met fin
brutalement à la carrière du plus « pictural » des romantiques (il était
un excellent dessinateur amateur).
(source Larousse)
Explication du titre : Un héros de notre temps
 |
| Un héros de notre temps |
Voilà qui donne une idée du grand poète et romancier russe qui marqua de son génie fulgurant la littérature russe romantique. Un héros de notre temps a été publié en 1840, rédigé par Lermontov pendant son année d'exil dans le Caucase où il avait été envoyé à la suite d'un duel.
Le roman qui se situe dans le Caucase et au bord de la mer Noire entre 1827 et 1833 évoque la figure de Petchorine, un riche jeune homme de bonne famille, brillant officier, courageux, impétueux, cultivé, charmeur, mais aussi blasé et désabusé, incapable de ressentir des sentiments profonds et en proie à l'ennui. Il incarne aux yeux de Lermontov, toutes les caractéristiques, qualités mais aussi faiblesses, de son époque : d'où le titre, Un héros de notre temps, qu'il faut prendre péjorativement si l'on en juge par la réflexion de l'auteur : Peut-être quelques lecteurs auront-ils l’envie de connaître mon opinion sur le caractère de Petchorin : Ma réponse est le titre du livre. Mais c’est une méchante ironie me dira-t-on !
Dans la préface l'auteur nous donne cet
avertissement en réponse à ses détracteurs qui croient reconnaître en
lui le personnage de Petchorine :
Le
héros de notre temps, mes très chers lecteurs, est réellement un
portrait, mais non celui d’un seul individu. Ce portrait a été composé
avec tous les vices de notre génération, vices en pleine éclosion. (…)
Si vous avez aimé des fictions beaucoup plus effrayantes et plus
difformes, pourquoi ce caractère ne trouverait-il pas grâce auprès de
vous comme toute autre fiction ?
C’est que, peut-être, il se rapproche de la vérité plus que vous ne le désirez.
Un roman composé de plusieurs récits
 |
| Circassienne XIX siècle |
Première partie
Il est, en fait, composé de plusieurs récits avec un point de vue est différent. Dans la première partie, avec Bela, le narrateur rencontre le vieux capitaine Maxime Maximitch qui lui raconte l'histoire de son ami, le jeune officier Grégoire Alexandrovitch Petchorin qu'il considère un peu comme un fils. Exilé en Géorgie, tout comme le fut Lermontov, après un duel,Petchorine tombe amoureux d'une belle circassienne, Béla, qu'il enlève. Mais après l'avoir séduite, il se lasse d'elle et recommence à s'ennuyer, responsable du destin tragique de la jeune fille.
Le narrateur accompagné du capitaine rencontre ensuite Petchorin mais celui-ci n'a n'aucun geste d'affection ou de reconnaissance envers son vieil ami qui souffre de ce désaveu. Ce second volet intitulé Maxime Maximitch dépeint bien un autre trait de caractère du héros, infidèle en amour et de plus incapable d'amitié ou de reconnaissance. Il peint aussi la différence de classe sociale entre le riche barine, Petchorin, officier promu à un brillant avenir et le capitaine issu du peuple.
Deuxième partie
La deuxième partie avec trois récits : Taman, La princesse Marie et Le fataliste change de point de vue. Le récit est maintenant raconté par Petchorin lui-même puisqu'il s'agit de son journal confié par le capitaine au narrateur. Ce dernier apprenant la mort de Petchorin se sent libre de publier ces pages qui complètent le portrait de ce héros de son temps! Dans la ville d'eau de Piatigorsk, le jeune homme se plaît à séduire la princesse Marie pour triompher de son rival mais il l'abandonne dès qu'il est parvenu à ses fins, désespérant la jeune femme. Auparavant dans le récit intitulé Taman qui se déroule au bord de la mer noire, il arrête un trafic de marchandises et risque y perdre la vie. Enfin Le fataliste expose les idées de Petchorin sur la liberté humaine et sa croyance au déterminisme.
Un pays, le Caucase
 |
| Alexandre Bide : Cavalier circassien au XIX siècle |
J'aime énormément ce roman parce qu'il nous montre un pays, le Caucase, avec ses paysages somptueux, ses peuples fiers et indépendants, qui doivent composer avec la domination russe sans s'y soumettre jamais vraiment. Les coutumes, les façons de vivre, les mentalités sont peintes avec beaucoup de talent et font de ces récits un livre balayé par le souffle de l'aventure, exalté par la beauté de la nature et des grands espaces, qui offre découverte et dépaysement.
Déjà le soleil commençait à se cacher derrière les cimes neigeuses, lorsque j’entrai dans la vallée de Koïchaoursk. Le conducteur circassien fouettait infatigablement ses chevaux, afin de pouvoir gravir avant la nuit la montagne, et à pleine gorge, chantait ses chansons. Lieu charmant que cette vallée !… de tout côté des monts inaccessibles ; des rochers rougeâtres d’où pendent des lierres verts et couronnés de nombreux platanes d’orient ; des crevasses jaunes tracées et creusées par les eaux et puis plus haut, bien haut, la frange argentée des neiges ; en bas l’Arachva qui mêle ses eaux à un autre ruisseau sans nom, et qui, se précipitant avec bruit d’une gorge profonde et obscure, se déroule comme un fil d’argent et brille comme un serpent couvert d’écailles.
Le roman rappelle le passé de cette région et de ses peuples conquis par les russes, une colonisation violente et sanglante qui a entraîné l'exode du peuple circassien et de nombreuses autres tribus vers l'empire Ottoman.*
 |
| Bataille entre les russes et les Circassiens Musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg / Alfredo Dagli Orti |
 |
| Le Caucase |
Nous
atteignîmes enfin le sommet du mont Gutt ; et instinctivement nous nous
arrêtâmes pour regarder derrière nous. Sur la pente, s’étendait un nuage
gris dont le souffle glacé nous menaçait d’un orage voisin ; mais à
l’Orient, tout était si clair et si doré, que le capitaine et moi
l’oubliâmes complètement, et surtout le capitaine. Dans les cœurs
primitifs, le sentiment de la beauté et de la grandeur d’une nature
vigoureuse est cent fois plus vivace qu’en nous, qui ne sommes
enthousiastes que des conteurs en paroles et sur papier.
Effectivement ;
il me semble qu’on trouverait difficilement un pareil panorama. Sous
nous, s’étendait la vallée de Koïchaoursk, sillonnée par l’Arachva et
par une autre rivière, comme par un double fil argenté ; une vapeur
bleuâtre glissait sur elle et courait vers les gorges voisines, chassée
par les rayons ardents du jour naissant. À droite et à gauche, les
crêtes des montagnes, d’inégale hauteur, ou bien coupées en deux,
s’étendaient sous un manteau de neige et un rideau d’arbres. De loin,
ces mêmes montagnes paraissaient être deux rochers parfaitement
ressemblants l’un à l’autre et tous deux, éclairés par les reflets
brillants de la neige, si gaiement et si chaudement, qu’il semblait
qu’on aurait pu s’arrêter là et y vivre toujours. Le soleil se montrait à
peine au-dessus d’une montagne bleu sombre, que seul un œil exercé
aurait pu ne pas prendre pour un nuage orageux. Sur le soleil,
s’étendait une raie sanglante que mon compagnon de voyage observa tout
particulièrement.
Le portrait de la société russe
 |
| Une dame de la noblesse russe : la comtesse Olga Chouvalova |
Les portraits dressés par Lermontov de la noblesse russe dans les villes d'eaux, des grandes dames coquettes et futiles et de leurs prétendants, des officiers pleins de ridicule et de suffisance, querelleurs, forment une histoire des moeurs du XIX siècle russe; c'est une société en proie à l'ennui, qui n'a plus d'élévation morale, brimée dans ses aspirations, un société finissante bien qu'elle se considère comme supérieure, étouffée par sa suffisance. Le vieux capitaine, Maxime Maximitch, représente lui, le peuple, sans grande culture mais doté de bon sens, d'une morale peut-être étroite, mais qui est encore capable d'éprouver des sentiments.
Maxime Maximitch : (Il) la suivait, en fumant une pipe de Kabarda montée en argent. Il portait une tunique d’officier sans épaulettes et un chapeau fourré de Circassien. On lui aurait donné cinquante ans : son teint basané indiquait qu’il avait fait depuis longtemps connaissance avec le soleil du Caucase, et ses moustaches, blanchies avant l’âge, ne répondaient point à son allure vigoureuse et à son air dégagé. Je m’approchai de lui et le saluai ; il répondit en silence à mon salut et lança une grande bouffée de tabac.
Grégoire Alexandrovitch Petchorin : c’était un excellent
garçon ; mais un peu singulier : ainsi, il lui arrivait de passer une
journée entière à la chasse par la pluie et le froid et lorsque tous
étaient transis et fatigués, lui ne l’était pas le moins du monde, et
puis d’autres jours où il n’avait pas quitté sa chambre, il se plaignait
de sentir le vent et assurait qu’il avait froid et si le volet battait,
on le voyait frissonner et blêmir. Je l’ai vu attaquer le sanglier tout
seul. Parfois il passait des heures entières, sans qu’on pût lui
arracher une parole, et d’autres fois, quand il se mettait à parler, on
se tenait les côtes à force de rire ; il avait de grandes bizarreries et
je crois que c’était un homme riche. Son bagage était considérable !
Un héros romantique
 |
| Pouchkine et Lermontov sont tous les deux morts dans un duel |
Grégoire Alexandrovitch Petchorin incarne le héros romantique, dans une société privée de liberté, où règne l'abolutisme du tsar Nicolas 1er. Les jeunes russes libéraux de cette époque ont vu leurs aspirations révolutionnaires réprimées avec brutalité dans la mort ou l'exil. On sait que Lermontov admirait fort les Décembristes. Petchorin ne croit plus en rien, il n'a plus d'espoir et se réfugie dans l'ennui, "le mal du siècle" à la russe, indifférent à tout, même à la mort. Il y a bien sûr une ressemblance entre de Mikhaïl Lermontov et Petchorine. Tous deux sont de la même classe sociale, tous deux ont été exilés au Caucase.
Eh bien ! Si je dois mourir, je mourrai, ce ne sera pas une grande perte pour l’univers ; moi-même, d’ailleurs, je m’ennuie ici, tel un homme qui ne quitte pas le bal où il s’ennuie pour retourner chez lui, parce que sa calèche n’est pas encore là. Mais la calèche est à la porte… Adieu ! »
Ceci est une lecture commune faite avec Miriam que vous pouvez aller lire ICI
* Bataille entre Russes et Circassiens.
Lors des jeux oympique de Sochi, les circassiens ont demandé à Poutine de reconnaître les massacres perpétrés par les russes lors des conquêtes du XIX siècle. Entre 500.000 et un million de Circassiens sont morts «de la faim, de la violence, de la noyade et des maladies», explique le journaliste et auteur Oliver Bullough. Les survivants des nombreuses tribus (Abkhazes, Oubykhs, Abazes,…) ont fui vers l’Empire ottoman. lire ici