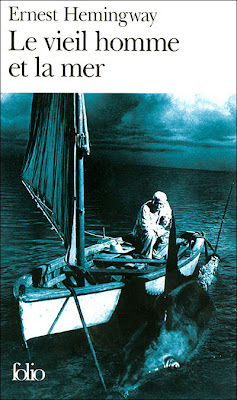Résultat de l'énigme n°54
Bravo à : Aifelle, Asphodèle, Dasola, Eeguab, Keisha, Pierrot Bâton, Shelbylee, Syl.
Le roman : Jane Eyre de Charlotte Brontë
Le film : Jane Eyre de Cary Fukunaga
Le roman de Charlotte Brontë, Jane Eyre est peut-être l'un de plus grands titres de la littérature anglaise du XIX siècle. Paru en 1847, sous le pseudonyme masculin de Currer Bell pour éviter de choquer la bonne société, il peut être classé par la date dans les oeuvres de l'époque victorienne qui s'appuient sur le réel et décrivent la société de leur temps. Mais il est appartient encore largement par la sensibilité, l'esprit, l'imagination et le style au mouvement romantique.
Le récit :
Orpheline, Jane Eyre est élevée par sa tante Madame Reed qui ne l'aime pas. Enfant sensible, imaginative et fière, elle se révolte contre son cousin qui la maltraite et est envoyée en pension.
Au pensionnat de Lowood, Jane Eyre connaît brimades, humiliations, mauvais traitements. Elle voit mourir sa jeune amie Helen Bruns. Mais grâce à la sympathie d'un de ses professeurs et à son amour de l'étude, elle acquiert une solide instruction et devient institutrice. Elle est engagée à sa majorité comme gouvernante de la petite Adèle chez le riche Edward Rochester à Thornfield Hall. Edward, tourmenté, secret, mystérieux, semble cacher un secret et une lourde peine. Il ne tarde pas à être s'intéresser à Jane qui, elle, se sent attirée par ce ténébreux personnage.
Un roman réaliste : Ce roman est largement autobiographique et s'appuie donc sur la réalité en présentant une étude de la société.
Le récit :
Orpheline, Jane Eyre est élevée par sa tante Madame Reed qui ne l'aime pas. Enfant sensible, imaginative et fière, elle se révolte contre son cousin qui la maltraite et est envoyée en pension.
Au pensionnat de Lowood, Jane Eyre connaît brimades, humiliations, mauvais traitements. Elle voit mourir sa jeune amie Helen Bruns. Mais grâce à la sympathie d'un de ses professeurs et à son amour de l'étude, elle acquiert une solide instruction et devient institutrice. Elle est engagée à sa majorité comme gouvernante de la petite Adèle chez le riche Edward Rochester à Thornfield Hall. Edward, tourmenté, secret, mystérieux, semble cacher un secret et une lourde peine. Il ne tarde pas à être s'intéresser à Jane qui, elle, se sent attirée par ce ténébreux personnage.
Un roman réaliste : Ce roman est largement autobiographique et s'appuie donc sur la réalité en présentant une étude de la société.
La pension: Charlotte Brontë a mis, en effet, beaucoup de sa vie, dans le récit de Jane Eyre. Comme Jane, Charlotte a été envoyée en pension, à l'école de Cowan Bridge, avec ses soeurs, comme elle, elle a eu à subir les mauvais traitements, le froid, le manque de nourriture, les punitions corporelles, la maltraitance inhérents à ce genre d'établissement qui se proposait de sauver l'âme en matant le corps. On sait comment les soeurs aînées de Charlotte, Maria et Elizabeth, ont contracté la tuberculose et en sont mortes. Charlotte et Emily sont alors retirées du pensionnat. L'amie de Jane, Helen Burns, qui meurt de consomption sous les yeux de la petite fille, a eu pour modèle Maria. L'odieux directeur de la pension dans le roman, Monsieur Brocklehurst, n'est autre que le Révérend Carus Wilson. Mais c'est aussi dans un de ces pensionnats pour jeunes filles que Charlotte (comme Jane) a pu acquérir une instruction solide, basée sur l'étude de l'anglais, des langues étrangères, du latin, de l'art, du dessin et de la musique. Jane Eyre est donc bien Charlotte Brontë, institutrice, comme le fut aussi sa soeur cadette Anne.
La misère : La société du XIX siècle apparaît avec sa terrible misère. Lorsque Jane erre dans les landes et les villages après son départ de chez Rochester, elle est obligée de mendier son pain et de coucher dans la lande. Elle se voit refuser tout aide de la part de gens qui sont plus pauvres qu'elle et qui se méfient des mendiants comme des voleurs, la misère conduisant souvent de l'un à l'autre.
La misère : La société du XIX siècle apparaît avec sa terrible misère. Lorsque Jane erre dans les landes et les villages après son départ de chez Rochester, elle est obligée de mendier son pain et de coucher dans la lande. Elle se voit refuser tout aide de la part de gens qui sont plus pauvres qu'elle et qui se méfient des mendiants comme des voleurs, la misère conduisant souvent de l'un à l'autre.
La hiérarchie sociale :Nous voyons aussi la stricte hiérarchie sociale à travers la famille de Madame Reed, la tante de Jane, qui l'a recueillie par charité mais lui fait sentir sans cesse le poids de sa supériorité.
La religion : Réalisme aussi dans l'analyse des mentalités. Jane décrit une Angleterre pliant sous le joug de la religion puritaine, qui brime le corps, va même jusqu'à lui refuser les soins nécessaires, pour fortifier l'âme. Un puritanisme qui tient en bride les sentiments, considère l'amour charnel comme secondaire et impur par rapport à l'amour divin. C'est le discours du pasteur Saint-John qui demande à Jane de l'épouser pour le suivre dans son sacerdoce aux Indes et estime qu'elle n'est pas née pour l'amour mais pour servir.
Un roman romantique
Un roman romantique
Un roman gothique : Jane Eyre s'apparente au roman gothique anglais qui dès la fin du XVIII siècle répond à un goût pour le sentimental et le mystère et à un engouement pour l'architecture médiévale que l'on redécouvre à l'époque. Ces écrivains, Walpole, Radcliffe, Lewis … sont les précurseurs du romantisme. Thornfield Hall est un immense château, mystérieux, sombre et austère, situé dans un paysage désolé, au milieu de la solitude, du froid et du brouillard. Dans le roman gothique il est peuplé d'âmes errantes, en proie au remords et au désespoir. Ici, il ne s'agit pas d'un fantôme mais d'une folle, enfermée dans une pièce secrète, gardée par une femme effrayante elle-même, dont l'antre rappelle l'antichambre de l'Enfer. Le feu, la destruction du château par l'incendie, toutes ces péripéties, participent à l'imagination débridée du romantisme. Charlotte et ses soeurs ont été marquées par les écrivains romantiques, Lord Byron ou Walter Scott…
Conception de l'amour romantique : Dans le roman de Jane Eyre, Charlotte Brontë développe sa conception de l'amour. Il présente les critères propres au romantisme : éternel, l'amour est l'union de deux êtres qui sont faits l'un pour l'autre; il résiste à l'usure du temps mais ne peut se réaliser que dans la vertu, un amour sanctifié et voulu par Dieu. Un sentiment désintéressé et si fort qu'il peut conduire à la rédemption de l'être le plus méprisable et le plus avili. C'est la cas d'Edward Rochester qui a une vie dissolue, allant de maîtresse en maîtresse, méprisant les femmes et se méprisant lui-même. Le Mal s'est emparé de lui puisqu'il s'expose à la damnation en décidant de contracter un double mariage. Lorsqu'il cherche à entraîner Jane dans sa déchéance en en faisant sa maîtresse, il perd tout sens moral car il risque de détruire ce qu'il aime dans la jeune femme, la luminosité qui permet à Jane de préserver cette dignité qui est sa force. Il doit, par une descente aux Enfers, obtenir le pardon divin, purifier son âme et se libérer du Mal.. Ses souffrances morales, la perte de Jane qui s'enfuit pour lui échapper s'allient à la douleur physique. Il risque sa vie pour sauver son épouse de l'incendie, frôle la mort et se retrouve infirme, diminué, mais digne de Jane.
Recours au surnaturel, au Merveilleux chrétien: Jane entend la voix de son Bien-aimé qui l'appelle au-delà des montagnes et il a lui aussi la même sensation. Nonobstant la distance, la voix et l'âme de ceux qui s'aiment peuvent se rejoindre.
Un roman féministe
Jane Eyre est un personnage apparemment faible. Orpheline, elle est méprisée et mal aimée par sa famille; pauvre, elle ne peut prétendre à la considération des autres. Chez sa tante, même les servantes la traitent comme une inférieure car elles gagnent leur vie, disent-elles, mais pas Jane; sans dot, elle n'a pas droit à l'amour et au mariage. De plus, la condition de gouvernante s'accompagne souvent d'humiliations et de rebuffades. Tout ceci va la placer tour à tour sous la coupe d'hommes qui cherchent à la dominer voire à la briser. C'est le cas du directeur de la pension qui lui inflige brimades et vexations. Ce sera ensuite Monsieur Rochester qui est son maître et à qui elle doit obéir. Il cherche à la manipuler, ne reculant pas devant le mensonge, au risque de la compromettre, de perdre son âme et de la pousser au désespoir : il la conduit à l'autel alors qu'il est déjà marié! Plus tard, il veut faire d'elle sa maîtresse, jouant sur ses sentiments, employant tour à tour, la séduction, la colère, les pleurs. Elle tombe enfin sous la coupe du pasteur Saint-John qui exercera sur elle, grâce à son ministère, une autorité incontestable sur son âme mais n'en cherchera pas moins à la dominer et la forcer au mariage avec lui sous prétexte de devoir religieux. Cependant Jane parviendra à tenir tête à tous ces hommes et à gagner sa liberté. Elle possède une valeur morale, une conception de l'honneur et un sens de sa dignité qui en font une héroïne à part entière. Elle force l'admiration et représente une conception de la femme libérée du pouvoir masculin, ne rendant des comptes qu'à elle-même et en paix avec sa conscience.
Le film de Cary Fukunaga
Conception de l'amour romantique : Dans le roman de Jane Eyre, Charlotte Brontë développe sa conception de l'amour. Il présente les critères propres au romantisme : éternel, l'amour est l'union de deux êtres qui sont faits l'un pour l'autre; il résiste à l'usure du temps mais ne peut se réaliser que dans la vertu, un amour sanctifié et voulu par Dieu. Un sentiment désintéressé et si fort qu'il peut conduire à la rédemption de l'être le plus méprisable et le plus avili. C'est la cas d'Edward Rochester qui a une vie dissolue, allant de maîtresse en maîtresse, méprisant les femmes et se méprisant lui-même. Le Mal s'est emparé de lui puisqu'il s'expose à la damnation en décidant de contracter un double mariage. Lorsqu'il cherche à entraîner Jane dans sa déchéance en en faisant sa maîtresse, il perd tout sens moral car il risque de détruire ce qu'il aime dans la jeune femme, la luminosité qui permet à Jane de préserver cette dignité qui est sa force. Il doit, par une descente aux Enfers, obtenir le pardon divin, purifier son âme et se libérer du Mal.. Ses souffrances morales, la perte de Jane qui s'enfuit pour lui échapper s'allient à la douleur physique. Il risque sa vie pour sauver son épouse de l'incendie, frôle la mort et se retrouve infirme, diminué, mais digne de Jane.
Recours au surnaturel, au Merveilleux chrétien: Jane entend la voix de son Bien-aimé qui l'appelle au-delà des montagnes et il a lui aussi la même sensation. Nonobstant la distance, la voix et l'âme de ceux qui s'aiment peuvent se rejoindre.
Un roman féministe
Jane Eyre est un personnage apparemment faible. Orpheline, elle est méprisée et mal aimée par sa famille; pauvre, elle ne peut prétendre à la considération des autres. Chez sa tante, même les servantes la traitent comme une inférieure car elles gagnent leur vie, disent-elles, mais pas Jane; sans dot, elle n'a pas droit à l'amour et au mariage. De plus, la condition de gouvernante s'accompagne souvent d'humiliations et de rebuffades. Tout ceci va la placer tour à tour sous la coupe d'hommes qui cherchent à la dominer voire à la briser. C'est le cas du directeur de la pension qui lui inflige brimades et vexations. Ce sera ensuite Monsieur Rochester qui est son maître et à qui elle doit obéir. Il cherche à la manipuler, ne reculant pas devant le mensonge, au risque de la compromettre, de perdre son âme et de la pousser au désespoir : il la conduit à l'autel alors qu'il est déjà marié! Plus tard, il veut faire d'elle sa maîtresse, jouant sur ses sentiments, employant tour à tour, la séduction, la colère, les pleurs. Elle tombe enfin sous la coupe du pasteur Saint-John qui exercera sur elle, grâce à son ministère, une autorité incontestable sur son âme mais n'en cherchera pas moins à la dominer et la forcer au mariage avec lui sous prétexte de devoir religieux. Cependant Jane parviendra à tenir tête à tous ces hommes et à gagner sa liberté. Elle possède une valeur morale, une conception de l'honneur et un sens de sa dignité qui en font une héroïne à part entière. Elle force l'admiration et représente une conception de la femme libérée du pouvoir masculin, ne rendant des comptes qu'à elle-même et en paix avec sa conscience.
Le film de Cary Fukunaga
Jane Eyre de Robert Stevenson
De même le récit dans la pension dans le film de Cary Fukunaga manque de relief et est filmé d'une façon assez plate. Je m'en suis rendue compte en revoyant l'adaptation de Robert Stevenson avec Orson Wells et Joan Fontain dans les rôles principaux. La scène de la pension est magiquement filmée, le style impressionniste accentuant les contrastes entre l'ombre et la lumière, entre le Bien et le Mal lorsqu'apparaît la petite Helen Burns (Elizabeth Taylor), symbole de la pureté et de la bonté, apportant du pain à Jane. Le film présente de très beaux passages dans ce film que je préfèrerais à celui de Cary Fukunaga… mais à qui je reproche un manque de sobriété encore accentué par une musique assez pompier dans les scènes tragiques.