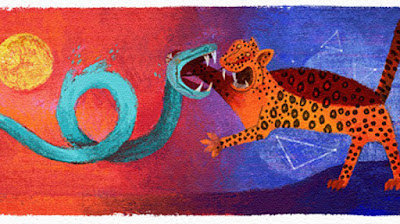Et dans ce livre aux voix multiples, Santagio Gamboa place Rimbaud, le poète de l’exil, comme personnage à part entière, devenu le sujet d’une biographie écrite par le narrateur. Ce dernier est toujours désigné par son titre, Consul, fonction qu’il a occupée en Inde dans le passé. C’est autour de lui que tournent tous les autres personnages qui se confient à lui. Consul est dépositaire de leurs secrets car c’est lui le romancier qui écrit leur histoire.
Le Consul est exilé en Italie, à Rome, mais une amie, Manuela, qu’il a perdu de vue depuis des années, lui demande de venir le rejoindre à Madrid où elle vit. C’est à Madrid aussi que se trouve Juana, elle aussi colombienne. Elle étudie la langue et la philologie espagnoles à l'université, occasion pour elle de fuir son pays, son enfance violente, la trahison d’une amie. Il y a aussi Tertuliano, un néo-nazi populiste, violent, illuminé athée, créateur d’un culte à la Terre, un de ces fous qu’il vaut mieux avoir comme ami plutôt que comme ennemi ! Enfin, le prêtre Palacios qui, pendant la guerre civile lutte contre les forces révolutionnaires et veut rétablir l’ordre et défendre la propriété et l’église. Il fait torturer et tuer de nombreuses personnes soupçonnées de complicité, en trahissant le secret de la confession. Lui ne repartira pas. Il est emprisonné et doit répondre de ses crimes.
 |
| Vues de Bogota (wikipédia) |
C’est le retour au pays. Le Consul retrouve sa ville natale, Bogota. Tout exilé porte en lui l’espoir du retour mais il est rarement synonyme de bonheur et d’apaisement. Retour impossible, source de désillusion. Nul ne peut retrouver son enfance et le passé est bien mort. Après nous avoir présenté, la Colombie des années de guerre, les exactions perpétrées sur les populations, les atrocités commises par une classe de riches propriétaires qui s’appuie sur des paramilitaires, tueurs exercés et sans états d’âme, et la toute puissance des cartels de la drogue, Santiago Gamboa dresse un tableau assez noir de la société colombienne actuelle. Bogota est à nouveau en paix, l’économie prospère mais elle n’est pourvoyeuse de richesses que pour les uns, exacerbant encore les inégalités sociales, laissant les autres dans la misère. Après la guerre civile, les colombiens sont condamnés à vivre ensemble aussi naît une société « du pardon » dont l’hypocrisie accable le consul et ses amis. Eux qui sont là pour accomplir une vengeance.
Santiago Gamboa est né le 30 décembre 1965 à Bogota. Il est une des voix les plus puissantes et originales de la littérature colombienne. Né en 1965, il étudie la littérature à l’université de Bogotá, la philologie hispanique à Madrid, et la littérature cubaine à La Sorbonne. Journaliste au service de langue espagnole de rfi, correspondant à Paris du quotidien colombien El Tiempo, il fait aussi de nombreux reportages à travers le monde pour des grands journaux latino-américains. Sur les conseils de García Márquez qui l’incite à écrire davantage, il devient diplomate au sein de la délégation colombienne à l’unesco, puis consul à New Delhi. Il vit ensuite un temps à Rome. Après presque trente ans d’exil, en 2014, il revient en Colombie, à Cali, prend part au processus de paix entre les farc et le gouvernement, et devient un redoutable chroniqueur pour El Espectador.
Sa carrière internationale commence avec un polar implacable, Perdre est une question de méthode (1997), traduit dans de nombreux pays, mais sa vraie patrie reste le roman (Esteban le héros, Les Captifs du Lys blanc). Le Syndrome d’Ulysse (2007), qui raconte les tribulations d’un jeune Colombien à Paris, au milieu d’une foule d’exilés de toutes origines, connaît un grand succès critique et lui gagne un public nombreux de jeunes adultes.
Suivront, entre autres, Nécropolis 1209 (2010), Décaméron des temps modernes, violent, fiévreux, qui remporte le prix La Otra Orilla, et Prières nocturnes (2014), situé à Bangkok. Ses livres sont traduits dans 17 langues et connaissent un succès croissant, notamment en Italie, en Allemagne, aux États-Unis.
Il a également publié plusieurs livres de voyage, un incroyable récit avec le chef de la Police nationale colombienne, responsable de l’arrestation des 7 chefs du cartel de Cali (Jaque mate), et, dernièrement, un essai politico-littéraire sur La Guerre et la Paix où il passe le processus de paix colombien au crible de la littérature mondiale. source ici Editions Métailié
Du côté de l'art :
Bien sûr, Ferdinando Botero reste le peintre colombien le plus connu en Europe.
Mais comme c'est justement un peintre moins connu que je veux présenter ici, j'ai choisi de vous parler d'une femme, Débora Arango, peintre engagée, qui a été mise au ban de la société et dont l'oeuvre a fait scandale et a subi la censure la plus rigoureuse.
Débora Arango
 |
| Debora Arango :Esquizofrenia en el manicomio, 19 40 |
 |
| Debora Arango : La République |
 |
| Debora Arango : La République (détail) |
Dans ce tableau, Débora Arango s’attaqua au dictateur Laureano Gomez, représentant le plus intransigeant du catholicisme, responsable du plus grand génocide de l’histoire colombienne moderne.
Quand enfin il abandonne le pouvoir, malade, Débora le peint en crapaud à la cravate tricolore. Sa civière est transportée par des vautours ; son cortège est mené par la camarde ; des hommes, curés, fanatiques, l’armée, les canons lui font des honneurs. Des petits crapauds-clones du malade sont chassés par le Général qui le succédera à la tête du pays dévasté.
Pour les curieux
*Ce qu'il est bon de se rappeler pour la lecture de ce livre (résumé)
Les
représentants des FARC signent le 26 septembre 2016 un accord de paix
avec le gouvernement. À la suite de cet accord, les FARC fondent le un parti politique légal.
Les paramilitaires
Autodéfenses unies de Colombie (AUC, Autodefensas Unidas de Colombia) sont le principal groupe paramilitaire colombien, fondé le 18 Avril 1987 à partir d'une unification des groupes paramilitaires pré-existants fondés à l'initiative de l’armée, de propriétaires terriens ou des cartels de drogue.
Les paramilitaires constituaient une force auxiliaire de l’armée colombienne "utilisée pour semer la terreur et détourner les soupçons concernant la responsabilité des forces armées dans les violations des droits humains." Pour les Nations-unies, les guérillas colombiennes seraient responsables de 12 % des assassinats de civils perpétrés dans le cadre du conflit armé, les paramilitaires de 80 % et les forces gouvernementales des 8 % restant. (Merci wikipédia)