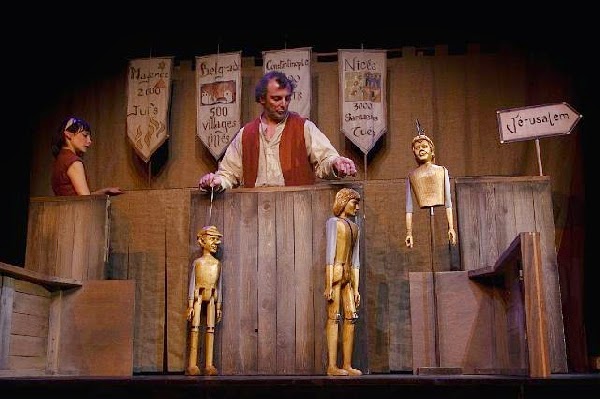L'action de Pensées secrètes se déroule dans le cadre de l'université fictive de Gloucester créée par David Lodge pour servir de cadre à ses personnages.
Dans Pensées secrètes un nouveau professeur de création littéraire, Helen Reed, elle-même romancière, arrive à l'université de Gloucester pour remplacer le titulaire du poste, le professeur Marsden qui, après avoir assuré le premier semestre, est parti en congé sabbatique. Helen vit à Londres, a deux enfants adultes et a besoin d'un changement dans sa vie. Son mari Martin est mort, il y a un an, et elle n'arrive pas à surmonter son chagrin. Elle fait ainsi connaissance de Raph Messenger, brillant professeur de sciences cognitives, mariée à Carrie qui possède une fortune personnelle et, à ce titre, un pouvoir certain sur son mari. Assez antipathique et même parfois carrément odieux, grand amateur de femmes, Messenger n'en est pas à sa première infidélité et n'a de cesse de mettre Helen dans son lit. D'éducation catholique, Helen est sensible au charme du séducteur quinquagénaire mais elle refuse l'adultère. Deux découvertes la feront changer d'avis : le roman que lui donne à lire une de ces étudiantes, Sandra Pickering, dont le comportement assez mystérieux l'a intriguée et le fait que Carie ait elle-même un amant. Telle est la trame de l'histoire réduite ici à son squelette autour de laquelle se greffent les agissements et les pensées des nombreux personnages qui vivent en vase clos sur ce campus et forment un microcosme complexe que l'auteur, comme un entomologiste, a tout loisir d'étudier voire de disséquer.
J'ai trouvé le thème principal du roman très intéressant. Il porte sur le débat philosophique et scientifique concernant la conscience et les différentes théories qui opposent les spécialistes entre eux selon leur appartenance à un courant de pensée. La science, à l'heure actuelle, s'intéresse en effet, à l'étude du cerveau jusqu'alors la partie de notre corps la plus méconnue, pour chercher à expliquer ce qui fait la conscience.
Nous savons que l'esprit ne relève pas de quelque univers immatériel, surnaturel, le fantôme dans la machine. Mais alors de quoi est-il fait? Comment expliquez-vous le phénomène de la conscience? S'agit-il seulement d'activité électrochimique du cerveau? De la décharge de neurones, de neurotransmetteurs libérés par les synapses? (Raph Messenger)
Ainsi, de nos jours, les progrès techniques, grâce au scanner, à l'IRM, permettent de repérer les zones du cerveau qui sont concernées par telle ou telle émotion. Mais comment cela se traduit-il en pensée se demande Ralph Messenger qui est persuadé que la science cognitive parviendra à le découvrir. Le cerveau n'est-il pas, en effet, semblable à un ordinateur à traitement parallèle qui met en même temps tous ses programmes en fonction? Le but des scientifiques est donc de parvenir à mettre au point un ordinateur capable de penser comme un être humain.
L'habileté de David Lodge est d'exposer ces théories complexes et ardues en les mettant à notre portée de manière à les rendre non seulement compréhensibles mais aussi passionnantes . Helen Reed joue ici le rôle du Candide à qui Messenger expose ses théories et fait découvrir les expériences en cours. En opposant Messenger à Helen Reed, le scientifique à la romancière, l'athée matérialiste à la catholique en proie au doute, David Lodge fait coup double. Si d'un point de vue scientifique il remet en cause le concept de l'âme immortelle (Y-a-t-il un fantôme dans la machine?) et de la dualité du corps et de l'esprit, il dénonce aussi la prétention des scientifiques qui sont loin d'avoir percé les mystères de la conscience car chaque individu est unique. En laissant le "mot de la fin " à Helen , il donne le point de vue de l'écrivain. Et si l'Homme finalement n'était pas une machine? La littérature, en fin de compte, n'est-elle pas allée plus loin jusqu'à maintenant que la science dans l'analyse de la conscience, de son cheminement obscur et de ses motivations secrètes?
Sans doute ai-je toujours cru que la conscience était le problème de l'art, particulièrement de la littérature, et plus particulièrement du roman.(...) Au fond je suis assez contrariée à l'idée que la science vienne fourrer son nez dans cette affaire, mon affaire à moi. Ne s'est-elle pas déjà approprié une part suffisante de la réalité? Doit-elle aussi avoir des prétentions sur l'essence intangible, invisible de la personne humaine? (Helen Reed)
La construction du roman assez complexe fait alterner les points de vue, celui de Messenger et de Reed mais aussi d'un narrateur omniscient si bien que certaines scènes sont narrées plusieurs fois selon le ressenti de chacun. Nous pénétrons ainsi dans les pensées intimes de Ralph et de Helen par le biais des notes privées dictées par le scientifique et par le journal de la romancière, ce qui nous permet de connaître l'intérieur de leur conscience, privilège du romancier non du scientifique selon la démonstration de l'auteur! D'ailleurs, Ralph ne connaîtra les pensées secrètes de Helen qu'en violant son journal et il ne sortira pas indemne de cette lecture puisqu'il y découvrira l'infidélité de sa femme. Je vois là l'ironie de David Lodge qui châtie ainsi son personnage et ridiculise ses certitudes.
Autre plaisir du roman, les devoirs que donne Helen à ses étudiants sur le thème de la conscience : comment c'est d'être une chauve-souris? ou sur Mary découvrant pour la première fois les couleurs. Ces travaux donnent lieu à des pastiches pleins d'humour imitant de grands écrivains.