Dans
Je vous emmène Joyce Carol Oates nous entraîne dans un campus américain pendant les années soixante. La jeune héroïne dont nous ne connaîtrons pas le prénom a dix neuf ans; elle vient d'un milieu modeste - son père est ouvrier- et a obtenu une bourse pour continuer ses études dans une grand université de l'Etat de New York.
Le livre est divisé en trois parties :
I) La pénitente qui nous fait pénétrer dans le cercle étrange, pour nous français, des sororités (fraternités pour les hommes) auxquels les étudiantes américaines se doivent d'appartenir si elles ne veulent pas se sentir exclues. Entrer dans une communauté de ce genre, c'est, en effet, un passage obligé, c'est se soumettre à une initiation, à des rituels secrets, c'est porter un insigne qui permet d'arborer son appartenance avec fierté, de partager des valeurs communes, d'être intégrée, considérée comme une soeur par les autres membres de la sororité. Notre héroïne choisit la maison Kappa Gamma Pi dont le luxe tapageur qui cache une certaine décrépitude l'éblouit. Mais avec ses revenus modestes, elle va vite s'apercevoir qu'elle ne peut faire face aux dépenses d'un tel établissement. Peu à peu, elle va apprendre à ses dépens que le mot "soeur" est un vain mot, elle va faire l'expérience la cruauté dont elle mais aussi la "Mère" de la maison Kappa Gamma, Mme Thayer, veuve désargentée, seront l'objet, elle va découvrir une réalité peu reluisante sous la façade d'apparat.
Dans cette première partie du roman le ton de Joyce Carol Oates est d'une puissance étonnante. Elle peint d'un trait acéré une Amérique où les inégalités sociales sont criantes, où celui qui n'est pas fortuné subit le mépris, la discrimination, les humiliations au quotidien. Ce n'est pas sans raison que la jeune fille n'a pas d'identité car dans la sororité personne ne retient son prénom, madame Thayer le déforme ; elle n'existe pas. L'écrivain décrit l'inhumanité de ces milieux aisés ou fortunés qui utilisent les autres quand ils peuvent les servir mais les rejettent sans scrupules ensuite. Elle dénonce la fausseté des apparences : ces jeunes filles de bonne famille prétendument bien éduquées, vertueuses (dans les années soixante, la liberté sexuelle n'est pas envisageable ), studieuses, se livrent à la débauche toutes les nuits, sexe, alcool, drogue et ne sont là que pour aller à la pêche au mari, fortuné, bien entendu. Les allers-retours du récit, de la famille désunie de la jeune fille à sa vie dans la sororité, véritable noeud de serpents, apportent chaque fois des précisions sur le caractère du personnage principal d'un intelligence supérieure, complexe, mal dans sa peau, malade jusqu'à l'anorexie, inadapté et marginal, d'abord soumis puis révolté.
Il s'agit ici d'un roman d'initiation d'une violence psychologique et verbale incisive, une découverte des réalités de la société qui enlève toute illusion à celle qui la subit. Le talent immense de Joyce Carol Oates, la complexité de l'analyse psychologique et des rapports sociaux, la richesse du contenu forcent l'admiration.
II) Négrophile est la deuxième partie. La jeune fille s'est libérée de la sororité et son initiation, cette fois-ci sexuelle, continue. Elle tombe amoureuse pour la première fois de Vernor, un noir, brillant étudiant en philosophie dont l'intelligence, l'érudition, les théories la captivent. Une occasion pour Oates de parler du racisme et de la ségrégation qui régnaient à cette époque. Mais les personnages perdus dans leurs considérations philosophiques passent à côté des revendications de l'époque. La jeune fille va se doter d'un prénom - Anellia - qui n'est pas le sien, elle va se donner une personnalité aux antipodes de la sienne. Comme si pour acquérir une identité et pour être vue par les autres, il fallait qu'elle renonce à elle-même. Son admiration pour Vernor l'amène à perdre, comme elle l'avait fait pour la sororité, sa lucidité et le le contrôle de sa vie. Là encore, elle découvrira à ses dépens qu'elle a été flouée. Il sera temps pour elle de s'accepter. Cette seconde partie reste intéressante et riche mais m'a cependant moins touchée, peut-être parce que la première était d'une force telle que je suis restée sur cette impression. Peut-être aussi parce qu'elle présente une structure trop semblable à la précédente.
III) L'issue : Le personnage découvre que son père qu'elle croyait mort est vivant mais gravement malade. Elle traverse tous les Etats-unis pour aller le voir et l'assister dans son agonie. Là, elle comprend que, contrairement aux apparences, celui-ci qu'elle croyait hostile, qui lui reprochait d'avoir causé la mort de sa mère par sa naissance, l'aimait. Avec la disparition du père finit l'initiation de la jeune fille qui entre dans l'âge adulte. La troisième partie ne m'a pas accrochée; je l'ai trouvée peu crédible. Je n'ai pas adhéré à ce dernier récit qui m'a paru ennuyeux. Ce parti pris de terminer sur une note optimiste ne m'a pas convaincue.





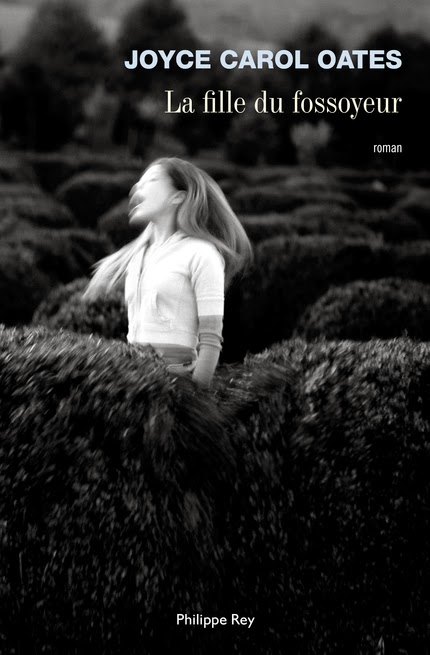


















 de Chiffonnette
de Chiffonnette