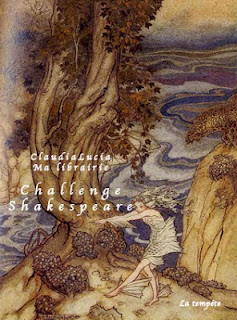La duchesse de Langeais a été publié en feuilleton en 1834 sous le titre Ne touchez pas à la hache, titre que Rivette a choisi pour son adaptation cinématographique. En 1843, La duchesse de Langeais (titre retenu par Baroncelli, réalisateur dont vous aviez à trouver le nom) fut intégré dans La comédie humaine, dans la section Histoire des Treize.
Le récit
 |
| La duchesse de Langeais de Baroncelli |
Nous sommes en 1823. Le général Armand de Montriveau s’introduit dans un couvent de carmélites, sur une île espagnole pour retrouver sous le nom de soeur Thérèse, la femme qu’il aime, Antoinette de Langeais. Le récit se déroule ensuite en flash back à Paris, dans le Faubourg Saint Germain, au temps de la première Restauration.
La duchesse de Langeais, riche aristocrate au coeur froid, orgueilleuse imbue des privilèges de sa classe, poursuit une vie factice, faite de bals, d’amusements, de conversations mondaines et de flirts. Elle collectionne les admirateurs, s’amusant à les provoquer mais leur opposant une vertu irréprochable. C’est le jeu qu’elle joue avec Armand de Montriveau, ancien général d’Empire. Celui-ci cherche à la conquérir mais en vain, la coquette le séduit, l’affole puis se dérobe. Mais le général n’est pas homme dont on peut se moquer. Il enlève la duchesse décidé à se venger. Puis il l’épargne mais la duchesse a compris qu’elle l’aimait. Désormais elle supplie son amoureux de lui revenir. Pour lui, elle est prête à sacrifier sa réputation mais Armand la dédaigne à son tour. La duchesse s’enfuit alors et prend le voile. Il faudra cinq ans à Montriveau pour la retrouver et chercher à nouveau à l’enlever mais cette fois-ci d’un couvent!
Le romantisme
 |
| La duchesse de Langeais Illustration de Andre E. Marty |
Si le roman La duchesse de Langeais part d’un fait réel, souvenir cuisant de Balzac repoussé par la duchesse de Castries à qui il avait avoué son amour, il est marqué par le romantisme de son époque. Il présente même un aspect gothique dès le premier enlèvement de la jeune femme, transportée dans un lieu inconnu par des hommes masquées, menacée d’être marquée au fer rouge comme dans un roman de Dumas. Les années de recherche à travers plusieurs pays d’Europe de l’amant inconsolable et le deuxième enlèvement sont autant d’éléments de cette atmosphère romantique. Montriveau et ses amis, prennent d’assaut les falaises de cette île qui protègent le monastère. Dans un décor et sous un éclairage éminemment gothiques, tout est en place pour conter une histoire terrible : les ombres de la nuit, le déguisement de Montriveau en religieuse, ses compagnons ayant chacun sur eux un poignard ( et détail incongru qui m’a fait sourire (?) : « une provision de chocolats »!), l’office des morts qui résonnent tandis qu’ils s’introduisent dans la cellule de Soeur Thérèse, la découverte de la morte à la lumière des cierges et le transport du corps jusqu’au navire…
Les personnages aussi rappellent d’autres héros romantiques, en particulier ceux de Stendhal. Montriveau quand il est repoussé par la duchesse alors qu’elle s’est presque donnée à lui réagit comme un Julien Sorel décrochant une arme pour tuer Mathilde de la Mole qui paraît le mépriser! L’orgueil et le sentiment de l’honneur sont très vifs chez les deux personnages. Le revirement de la duchesse de Langeais qui découvre soudain son amour quand elle va être marquée par son amant est semblable à la réaction de Mathilde exaltée d’avoir failli être tuée par son amant. Le ressemblance des deux femmes et des deux hommes s’arrêtent là : Mathilde à les défauts de sa classe sociale mais n’est pas prude, étroite d’esprit, confite en dévotion. Elle est intelligente, elle lit les philosophes, elle a des idées avancées. Julien Sorel n’appartient pas à la noblesse, il est ambitieux mais naïf et capable d’amour vrai, ce dont on peut douter pour Armand de Montriveau. Les personnages de Balzac ne sont pas sympathiques.
Et d’ailleurs le dénouement si terre à terre du roman me paraît être de la part de Balzac le refus de l’émotion, une réaction anti romantique voire cynique! Ultime petit coup de griffe décoché à la duchesse de Castries?
Ah! ça dit Ronquerolles à Montriveau quand celui-ci reparut sur le tillac, c’était une femme, maintenant ce n’est rien. Attachons un boulet à chacun de ses pieds, jetons-la à la mer, et n’y pense plus que comme nous pensons à un livre lu pendant notre enfance.
- Oui, dit Montriveau, car ce n’est plus qu’un poème.
-Te voilà sage. Désormais aie des passions; mais de l’amour, il faut savoir le bien placer, et il n’y a que le dernier amour d’une femme qui satisfasse le premier amour d’un homme. »
Le réalisme
 |
| Antoinette et Armand Dessin de Louis Edouard Fournier |
Mais La duchesse de Langeais est aussi un peinture réaliste de la noblesse au moment de la restauration et de l’avènement de Louis XVIII. Le but de l’auteur est de décrire la déchéance d’une classe sociale qui pour survivre devrait être grande. Son manque de hauteur, sa frivolité la condamnent. Les hommes de valeur jugés dangereux sont écartés du pouvoir et ne gouvernent que les hommes médiocres. Le Faubourg Saint Germain dont la duchesse de Langeais et ses chevaliers servants sont les représentants est animé d’une vie vaine, sans idées, sans aspirations. L’église règne en maître sur cette société, les femmes ont leur confesseur, tous suivent la messe, la plupart du temps non par conviction réelle mais parce qu’il faut suivre les « usages du monde » et que la religion est un moyen de soumettre le peuple: La duchesse est très lucide à ce sujet et déclare:
Si nous voulons que la France aille à la messe, ne devons-nous pas commencer par y aller nous-mêmes? La religion, Armand, est, vous le voyez, le lien des principes conservateurs qui permettent aux riches de vivre tranquilles. La religion est intimement liée à la propriété.
Toutes les moeurs reposent sur l’hypocrisie. Les femmes peuvent y tromper leur mari à condition que personne ne soit au courant :
Une imprudence, c’est un pension, une vie errante, être à la merci de son amant; c’est l’ennui causé par les impertinences des femmes qui vaudront moins que toi, précisément parce qu’elles auront été très ignoblement adroites. Il valait cent fois mieux aller chez Montriveau, le soir, en fiacre, déguisée, que d’y envoyer ta voiture en plein jour. Tu es une petite sotte, chère enfant.
Les maris, eux, peuvent s’afficher avec leurs maîtresses avec plus de liberté et ils ont tout pouvoir sur la fortune de leur femme. Balzac résume cela dans des formules lapidaires d’une méchanceté et d’une lucidité glaçantes! Voilà les conseils donnés à la duchesse par son oncle :
Renoncez à votre salut en deux minutes, s’il vous plaît de vous damner; d’accord! Mais réfléchissez bien quand il s’agit de renoncer à vos rentes. Je ne connais pas de confesseur qui nous absolve de la misère.
La situation de la femme certes n’est pas enviable. Elle est mariée contre son gré par son père et est désormais à la merci d’un époux qui peut tout se permettre et qui dans le cas de la duchesse n’est jamais entré dans son lit..
Si vous tentez à faire un éclat, je connais le sire, je ne l’aime guère. Le duc est assez avare, personnel en diable; il se séparera de vous, gardera votre fortune, vous laissera pauvre, et conséquemment sans considération. Les cent mille livres de rente que vous avez héritées dernièrement de votre grand tante maternelle payeront les plaisirs de ses maîtresses, et vous serez liée, garrottée par les lois, obligée de dire amen à ces arrangements-là.
Armand de Montriveau représente une autre sorte de noblesse; celle d’Empire; Après avoir d’abord été écarté avec le retour des Bourbons, il est ensuite réintégré dans l’armée et retrouve son grade. Mais il ne fait pas de compromis et a son franc parler, il peut être direct et même brutal. A la différence des autres, ce n’est pas un courtisan. Il annonce une nouvelle révolution si la noblesse ne sait pas évoluer.
Une lutte amoureuse pour la domination
 |
| Ne touchez pas à la hache de Jacques Rivette |
L’amour d’Antoinette et d’Armand apparaît le plus souvent comme un rapport de force. Chacun lutte pour la domination de l’autre. La duchesse n’aime pas Montriveau, elle veut qu’il soit à ses pieds, qui lui rende hommage, qu’il manifeste de la dévotion pour elle. C’est une coquette et une hypocrite. Elle aime jouer avec le feu, être prête à céder puis reculer au dernier moment en invoquant dieu, sa vertu, son devoir d’épouse. Mais elle n’a jamais eu l’intention de se donner à lui. Elle veut le dominer. Ensuite elle a l’intention de le repousser comme elle l’a fait pour les autres et se moquer de lui. Le général, au début, en bon soldat, aime conquérir, prendre d’assaut. Le jeu l’amuse mais lorsque la forteresse se révèle imprenable, il dépite; quand enfin, il apprend par son ami Ronquerolles que la duchesse s’amuse de lui comme elle l’a fait tour les autres, il devient furieux et il l’enlève. Mais il ne s’abaissera pas au viol, il veut faire pire, la marquer au fer rouge car il prouvera qu’elle lui appartient. Là encore le rapport entre eux est celui de la domination. Si dans la première partie de la lutte, la duchesse de Langeais était victorieuse, dans la seconde partie, le renversement de la situation la rend soumise et implorante et Montriveau intraitable. C’est elle qui perd. Lorsqu’il la retrouve au couvent, Montriveau ne lui demande pas son avis, il décide de l'enlever. Il se comporte toujours en officier qui veut remporter la victoire et forcer la citadelle. Seule la mort peut mettre fin à ces rapports passionnés, certes, mais finalement assez monstrueux.
C’est ce qui amène Balzac à distinguer la passion de l’amour :
L’amour et la passion sont deux différents états de l'âme que poètes et gens du monde, philosophes et niais confondent continuellement. L'amour comporte une mutualité de sentiments, une certitude de jouissances que rien n'altère, et un trop constant échange de plaisirs, une trop complète adhérence entre les coeurs pour ne pas exclure la jalousie. La possession est alors un moyen et non un but ; une infidélité fait souffrir, mais ne détache pas ; l'âme n'est ni plus ni moins ardente ou troublée, elle est incessamment heureuse ; enfin le désir étendu par un souffle divin d'un bout à l'autre sur l'immensité du temps nous le teint d'une même couleur : la vie est bleue comme l'est un ciel pur. La passion est le pressentiment de l'amour et de son infini auquel aspirent toutes les âmes souffrantes. La passion est un espoir qui peut-être sera trompé. Passion signifie à la fois souffrance et transition ; la passion cesse quand l'espérance est morte.
voir le billet de Maggie
Le livre : La duchesse de Langeais de Honoré de Balzac
Le film : La duchesse de langeais de Jacques de Baroncelli
Le prix Balzac est attribué aujourd'hui à : Aifelle, Dasola, Eeguab, Miriam