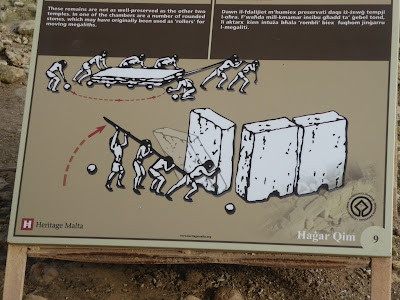Barkus de Patricia MacLachlan, illustrations de Marc Boutavant, traduit en français par Nathalie Pelletier, est paru dans aux éditions
Little Urban collection
Premiers romans.
L’oncle Alfred arrive à la maison de Lilou avec un cadeau pour elle et ce cadeau, c’est Barkus,
« le chien le plus intelligent du monde » ! Entre la petite fille et Barkus, naît une belle histoire d’amitié.
Le livre est divisé en petits chapitres qui portent un titre différent :
Barkus file à l’anglaise, Joyeux anniversaire Barkus, Barkus et Robinson, l’heure des histoires.
 |
| L'anniversaire de Barkus |
Histoires charmantes, proches de l’univers de l’enfant : l’amitié avec un chien et les joies qu’elle procure, l’école, l’arrivée d’un petit chat, une nuit sous la tente , toutes sont simples et respirent le bonheur.
Le livre me paraît convenir parfaitement aux enfants de CP qui savent lire mais peut aussi être lu aux plus petits. Ma petite fille qui a neuf ans l’a bien aimé mais le trouve un peu « bébé ». Les illustrations sont sympathiques et joyeuses. Un livre agréable et plaisant.
Merci à Masse critique et aux éditionsLittle urban premiers romans.