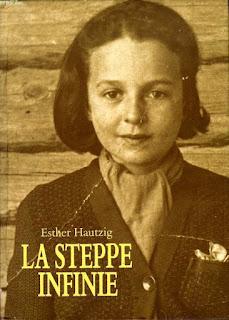L'affiche du 75 ième festival d'Avignon a été composée par l'artiste Théo Mercier qui explique ainsi son oeuvre
"L’image est composée de la reproduction d’une page d’un livre sur la
collection d’objets du musée anthropologique de Mexico City datant des
années 1960, sur laquelle j’ai disposé une de mes peintures de tranche
d’agate. C’est un collage, une superposition de deux éléments. La pièce
de musée est un masque aztèque mortuaire en obsidienne, la pierre
superposée devient le masque du masque. Elle obstrue la vision du
personnage, mais nous permet, à nous spectateurs, de contempler le
paysage intérieur de ce visage. "
Comme je suis optimiste, j'affirme : le festival d'Avignon 2021 aura lieu. C'est du moins ce que nous dit Olivier Py, le directeur du festival. Pour le In, il se déroulera du 5 au 25 juillet.
Aujourd'hui, mercredi 24 Mars, en conférence de presse, Olivier Py a d'abord présenté le festival et les spectacles d'une manière générale puis a laissé place à chaque metteur en scène qui est venu expliquer sa conception de la pièce.
Le thème du festival est : se souvenir de l'avenir Et si la Culture n’était pas la recherche du temps perdu, mais la
recherche du temps à venir ? Et si nous pouvions, par le poème et la
réunion des bonnes volontés, changer ce qui a été, en lui donnant
d’autres conséquences ?
Je ne vais pas vous détailler tous les spectacles et je vous invite à cliquer sur ce lien.
https://festival-avignon.com/fr/edition-2021/programmation/par-date
Mais j'ai envie d'en sélectionner au moins quelques uns que j'ai déjà envie de voir. C'est un à priori parce que j'ai le temps de m'intéresser encore à d'autres représentations d'ici le mois de juillet !
 |
| La Cerisaie |
La Cerisaie
Anton Tchekhov
Tiago Rodriguez
Il débutera à la cour d'Honneur par La cerisaie de Tchékhov dans une mise en scène de Tiago Rodriguez et dans le rôle principal Isabelle Huppert. Le metteur en scène a exprimé sa joie de se confronter avec les mots d'un des plus grands écrivains de tous les temps. Le thème de l'oeuvre théâtrale porte sur l'incertitude de l’avenir, l'angoisse qui vient avec les changements profonds, mais le metteur en scène ne veut pas que cela soit placé sous le signe de la nostalgie, car l'annonce des temps nouveaux est aussi porteuse d'espoir. Pourquoi la Cerisaie ? Parce que La Cerisaie ! Parce que Tchékhov ! Parce que Tiago Rodriguez !
 |
| La Petite dans la forêt profonde |
La Petite dans la forêt profonde
Η Μικρή μέσα στο Σκοτεινό Δάσος
de Philippe Minyana
Pantelis Dentakis
Sur une scène miniature, le mythe sanglant de Procné et Philomèle se
raconte à la manière d’un conte fantastique. Tels des joueurs d’échecs,
deux acteurs face à face déplacent, au plateau et à vue, cinq
personnages sous emprise. Sous l’emprise de qui ? Du destin, tout
simplement. Pantelis Dentakis fait de La Petite dans la forêt profonde, récit tiré des Métamorphoses
d’Ovide et adapté par Philippe Minyana, une pièce indisciplinaire
composée de théâtre, de micro-sculptures, de vidéo et d’une œuvre
musicale terrifiante. L’histoire se joue sur plusieurs niveaux de sens
métaphoriques et visuels, entre l’infiniment petit et l’infiniment
grand, entre les inanimés et le vivant, entre le vécu et le projeté dans une esthétique empruntant au film d’horreur, travail du metteur
en scène grec Pantelis Dentakis.
Philippe Minyana est un auteur que j'apprécie et je verrai donc cette mise en scène avec curiosité et plaisir (En grec sous-titré).
 |
Pupo di Zucchero
|
Pupo di Zucchero - La Festa dei morti
La Statuette de sucre - La Fête des morts
Emma Dante
Le jour du 2 novembre, c'est la fête des morts. Et des morts, il y en a
ici beaucoup : de toute la famille il ne reste plus qu'un vieillard,
seul dans une maison emplie de souvenirs. Alors, pour offrir la plus
belle des fêtes à tous ses parents défunts et les rappeler à lui, il
leur prépare une statuette de sucre, comme le veut la coutume en Italie
du sud. Voilà soudain que les morts se matérialisent autour de lui,
virevoltent, comme rendus à la vie par le souvenir de leur dernier
parent. Comme s'ils n'étaient jamais partis. Mais si le 2 novembre est
une nuit bien singulière, arrivera le lendemain et ne restera plus,
autour de la table de fête, que la solitude du vieil homme... S'appuyant
sur des traditions typiques de sa Sicile natale, Emma Dante invente une
célébration baroque et pleine de vie, mâtinée de musique et de danse,
pour évoquer un thème cher à son cœur et universel : la mémoire des
morts – et la continuité de leur vie chez nous, vivants. Le thème me plaît, la tradition sicilienne, la scénographie, les masques, la marionnette... Je n'ai encore rien vu d'Emma Dante mais il y a deux spectacles d'elle pendant ce festival.
 |
| Kingdom |
Kingdom de Anne-Cécile Vandalem
Trois décennies d’une saga familiale aux confins de la taïga et d’une utopie. Un conflit vu par le prisme des caméras et à hauteur d’enfants. Un royaume à défendre, dans une nature aussi belle qu’inquiétante.Un baraquement formé de deux maisons où devant coule une rivière. D’un
côté la forêt, et au-delà de la barrière, le territoire de l’autre.
Partie aux confins de la taïga sibérienne pour fuir le bruit du monde et
reconstruire un mode de vie idéalisé, une famille, rejointe par sa
branche cousine, est rattrapée par tout ce à quoi elle tentait
d’échapper. Entre guerre de territoires, braconnage, incendies, et une
vie qui doit composer avec la nature et les animaux sauvages, se joue un
drame épique, un conflit ancestral. Librement inspiré du film
documentaire Braguino de Clément Cogitore, Kingdom est le dernier volet d’une trilogie commencée avec Tristesses et Arctique . J'ai déjà vu les deux premiers de la trilogie et apprécié le travail de la metteure en scène. Alors, il me faut voir ce troisième volet.
 |
Pinocchio live 2
|
Pinocchio(live)#2
Alice Laloy
Strasbourg - Colmar / Création 2021
Dans un atelier aux allures de chaîne d’assemblage, des marionnettistes
s’affairent au-dessus d’établis pour fabriquer des Pinocchios. Non pas,
comme nous pourrions nous y attendre, en les sculptant dans le bois,
mais en acheminant des enfants à se métamorphoser en pantins…
S’inspirant du mythe de Pinocchio pour le retourner comme un gant, Pinocchio(live)#2
nous propose d’entrer dans un univers dystopique et d’assister « en
direct » à une expérience troublante, fascinante, dérangeante. À quoi
ressemble un enfant humain quand il est transformé en objet par un
adulte ? Et vice versa ? Après un travail de recherche mené sur
plusieurs années, la marionnettiste Alice Laloy écrit ici un spectacle
aux frontières de la danse, des arts plastiques et de la performance,
porté par de jeunes élèves du Centre chorégraphique de la Ville de
Strasbourg et du Conservatoire de Colmar. De quoi inventer une
mythologie nouvelle du geste créateur. Le thème, l'originalité du spectacle m'attirent.
 |
Y aller voir de plus près
|
Y aller voir de plus près
Maguy Marin
Sainte Foy-lés-Lyon / Création 2021
Figure incontournable de la danse contemporaine, Maguy Marin construit
une œuvre engagée, peuplée d’individus qui tentent de faire communauté
alors qu’ils sont pris dans une tempête. Inspirée par La Guerre du Péloponnèse
de Thucydide, chef d’œuvre de la littérature antique, cette création ne
déroge pas à ses convictions. Sur le plateau, deux hommes et deux
femmes se retrouvent au milieu de costumes qu’ils endossent, d’objets
qu’ils manipulent, d’écrans qui les conduisent. Enfants perdus ou
troublés, ils saisissent chaque indice comme des archéologues
trouveraient des fragments d’histoires ensevelis et oubliés. Ils
s’essaient aux jeux de la vie, de la domination et de l’emprise qui nous
submerge face à plus faible que soi. Avec en sous texte : comprendre
les mécanismes au cœur des guerres et qui fabriquent de la violence. Choisi pour Maguy Marin.
Il y aura aussi Nicole Garcia dans Royan. La professeure de français de Marie NDiaye mise en scène par Frédéric Bélier Garcia
Olivier Py crée un Hamlet à l'impératif, série de dialogues entre les personnages de la pièce.
et avec France culture dans le cadre du cycle "Fictions" : Sandrine Bonnaire et le trompettiste Erik Truffaz, autour des carnets de Goliarda Sapienza, Fabrice Lucchini lira des textes entre Baudelaire et Nietzsche et Omar Sy lira "Frères d'âme" de David Diop.
Je vous accorde que c'est plutôt sombre comme programme ! Mais je ne sais pas si le festival In et les metteurs en scène actuels ont jamais eu envie de rire. Enfin, il paraît qu'il y a de l'espoir !