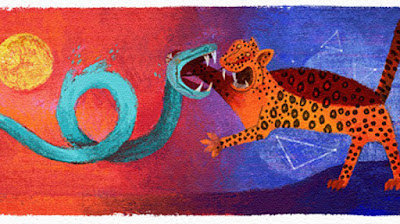Le siècle des Lumières de Alejo Carpentier, écrivain cubain, c’est, la Révolution française et ses répercussions dans les Caraïbes, à Cuba où débute l’action puis à la Guadeloupe, via Paris et Bordeaux, pour arriver en Guyane.
Trois jeunes cubains, personnages fictifs et attachants du roman, Esteban, sa cousine Sofia et son cousin Carlos, vont être les témoins de cette époque tourmentée. Pour Esteban, en particulier, cette période va représenter une initiation cruelle, qui lui fera perdre naïveté, confiance et espérance.
 |
| Victor Hugues |
Esteban quitte la Havane pour suivre son ami Victor Hugues, personnage historique, ancien négociant, fervent admirateur de Robespierre. Victor devient accusateur public à la Rochelle avant de partir pour la Guadeloupe afin d’y abolir l’esclavage. Moments de réjouissance et de bonheur vite suivis, dans la foulée, par l’utilisation de la guillotine que l’accusateur public a transportée avec lui. Victor Hugues reprend l’île aux britanniques et organise la guerre de course (corsaires) qui va créer une classe de nouveaux riches. A la fin de la Révolution, loin de tomber en disgrâce, Victor Hugues devient gouverneur en Guyane et applique, sans état d’âme, le nouveau décret qui rétablit l’esclavage, opérant ainsi un grand retour en arrière et abolissant tout espoir d’un monde meilleur.
Tout le pessimisme de Carpentier-Esteban s’exprime ici. C’est comme si la révolution n’avait pas existé, que les gens étaient morts pour rien, comme si les idées positives de cette période avaient été ensevelis sous les actes de la Terreur, la corruption des esprits, l’ambition et l’avidité humaines, le reniement de soi-même.
Ce vaste panorama de la révolution, magnifique élan des peuples opprimés, qui débute par l’espoir de la liberté et de l’égalité, vire donc peu à peu au cauchemar aux yeux d’Esteban qui perd toutes ses illusions. Pourtant quand il parvient à fuir en Guyane néerlandaise avant de regagner Cuba, et qu’il voit, comme nous l’a montré Voltaire, que l’on coupe les pieds ou les mains des esclaves marron, il comprend l’urgence de la révolution.
En fait, Esteban, disciple de Victor Hugues, fait souvent penser à Candide, disciple de Pangloss, mais s’il subit les mêmes désillusions, il n’aura pas, comme le héros de Voltaire, le temps de cultiver son jardin.
En revenant à La Havane, il ne pourra pas transmettre son expérience désenchantée à Sofia et Carlos, ceux-ci ayant toujours foi dans la révolution des Lumières. La jeune fille devra faire elle-même son expérience.
 |
| Jean Nicholas Billaut Varenne |
Alejo Carpentier peint avec habileté les changements qui s’opèrent dans l’âme humaine. Victor Hugues quand il fait connaissance des adolescents, Esteban, Sofia et Carlos, à la Havane, est un jeune homme sympathique, un peu tapageur et suffisant, mais amusant et amical. L’amitié des trois enfants, livrés à eux-mêmes après la mort de leur père, et du jeune homme étranger, français de Marseille, dans le fouillis de cette maison-capharnaüm est un instant de grâce. Un peu comme le jardin de l’Eden avant la chute. C’est un moment de bonheur aussi pour le lecteur. Mais peu à peu Victor Hugues se transforme. Lorsque Esteban le retrouve à La Rochelle où il fait tomber les têtes à un rythme soutenu, l’homme qu’il est devenu n’a plus rien d’humain. Et il finira par oublier ses idées. Il y aussi des moments très forts quand, en Guyane, nous rencontrons tous les révolutionnaires, sauvés de l’échafaud mais envoyés au bagne. C’est une sorte d’enfer dantesque qui est décrit, avec les différents cercles, tous prêts à renier leurs idées, sauf un, au centre, Billaut-Varenne, membre du comité de salut public, partisan de la terreur, qui a fait tomber la tête de Robespierre ! Des portraits qui marquent !
Un style baroque
 |
| Henri Rousseau dit le douanier |
Alors certaines créatures végétales d'en bas prenaient des silhouettes nouvelles : les papayers avec leurs mamelles suspendues autour du cou, semblaient s'animer, s'acheminer vers les lointains fumeux de la Soufrière : le fromager "père de tous les arbres" comme disaient certains nègres, prenaient davantage la forme d'un obélisque, d'une colonne rostrale, d'un monument, et sa taille croissait contre les feux du crépuscule. Un manguier mort se transformait en un faisceau de serpents immobilisés dans leur élan pour mordre, ou bien encore, vivant et débordant de sève qui suintait à travers l'écorce et les peaux jaspées de ses fruits, il fleurissait soudain et s'enflammait de jaune. Esteban suivait la vie de ces créatures avec l'intérêt que pouvait lui inspirer le développement d'une existence zoologique.
Si le récit est riche en aventures et en histoire des idées, le style ne l’est pas moins ! Je comprends que l’on parle de style baroque à propos d’Alejo Carpentier, tant le foisonnement de ses descriptions, la profusion des couleurs, des sons, des odeurs, des détails de toutes sortes, l’abondance et la richesse du vocabulaire sont des ornements éblouissants.
Ce n’est pas sans raison qu’il montre son héros Esteban « jouir de l’euphorie des mots ».
« Esteban était rempli d’étonnement quand il remarquait que le langage, en ces îles, avait dû utiliser l’agglutination, l’amalgame verbal et la métaphore, pour traduire l’ambiguïté formelle des choses qui participaient à plusieurs essences. De la même façon que certains arbres étaient appelés, « acacias-bracelets », « ananas-porcelaine », « bois-côte, « balai-dix heures », « cousin-trèfle », « pignon-gargoulette », « tisane-nuée », « bâton-iguane », de nombreuses créatures marines recevaient des noms qui, pour fixer une image, établissaient des confusions de mots, engendrant une zoologie fantaisiste de poissons-chiens, de poissons-boeufs, de poissons-tigres, de poissons ronfleurs, souffleurs, volants, à queue rouge, rayés, tatoués, fauves…. »
Et son érudition couvre tous les domaines, qu’il parle de fonds sous-marins, d’histoire, de philosophie, de musique, d’ethnologie, de géographie, de végétation tropicale, c’est toujours incroyablement riche, précis, minutieux et pourtant poétique et visionnaire.
Certains matins à l’aube, la mer était si calme et silencieuse que les craquements isochrones des cordes aux tonalités plus aiguës ou plus graves selon qu’elles étaient plus courtes ou plus longues se combinaient de telle sorte que de la poupe à la proue c’étaient des anacrouses et des temps forts, des appoggiatures et des notes piquées, avec le rauque point d’orgue issu d’une harpe formée par des câbleaux tendus, soudain pincés par un alizé.
Un auteur, donc, que je découvre avec admiration et que je veux suivre avec d’autres lectures ! Et oui, encore un !
Alejo Carpentier, écrivain cubain
Quelques titres : "Le partage des eaux", "Concert baroque", "Le royaume de ce monde"
Art : peinture cubaine
Ruperto Jay Matamoros ( 1912- 2008)
 |
| Le fermier de Ruperto Jay Matamoros |
En 2000, à l'âge de 88 ans, Jay Matamoros a reçu la médaille du 270e anniversaire de l'Université de La Havane et a été honoré du prix national des arts visuels. L'occasion a été présentée par une exposition rétrospective personnelle au Museo Nacional de Bellas Artes, à La Havane.
Jay Matamoros est décédé à l'âge de 95 ans à La Havane en 2008. (source ici )