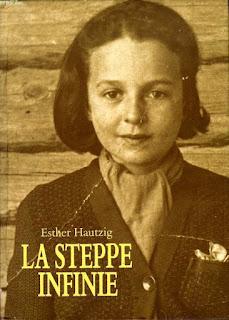Encore un très beau livre d’Olga Tokarczuk, Dieu, le temps, les hommes et les anges. L’écrivaine a ce talent inimitable de nous maintenir entre le réel souvent tragique dans cette tranche du XX siècle qui englobe deux guerres mondiales, et le surnaturel, Anges, Dieu, Ombres des morts, dans lequel il faut accepter de se perdre car il est poésie mais aussi prétexte à une réflexion philosophique. Olga Tokarczuk nous amène donc, comme souvent, dans une frange indéfinie entre réalité et fantaisie où tout est transcendé par l’écriture : la violence des combats et des rapports humains, la déportation et le massacre de la population juive dans un décor champêtre, les viols, la bestialité de l’homme (Le mauvais bougre, qui se transforme en animal) ; la grande Histoire se mêle à la petite, amour contrarié, sacrifié au devoir, (Geneviève), amour paternel (Michel et sa fille Misia), misère physique et morale (la Glaneuse), enfance saccagée (Isidor) et dominant le tout, le Temps, le temps qui passe et met à mal, celui contre lequel nul ne peut rien, même pas Dieu.
Le livre est divisé en chapitre, si l’on peut employer ce terme, comme autant de petits récits qui pourtant ne sont pas indépendants comme on pourrait le croire au début, mais se répondent, introduisant des personnages secondaires qui réapparaîtront par la suite, propulsés sur le devant de la scène, devenant à leur tour personnages principaux. Entrées, sorties, côté cour, côté jardin, arrière-scène, coulisses, comme dans un théâtre, celui du Monde tel que le voit Shakespeare.
Intitulés Le Temps de Geneviève au début de la guerre de 1914, Le temps de la Glaneuse, Le temps des anges gardiens, Le temps d’Isidor… tous ces récits sont ainsi placés sous le signe du Temps, qui est, fut et sera toujours le grand gagnant de l’histoire. A remarquer aussi que le village se nomme Antan et est situé « au milieu de l’univers ».
 |
| Vierge noire Pologne |
Dans cette galerie de personnages où se mêlent Dieu, les anges et les humains, les êtres surnaturels ne sont dotés d’aucun pouvoir. Au contraire, Dieu comme les anges assistent, impuissants, à la sauvagerie humaine
Qui suis-je se demande Dieu. Dieu ou homme ? Peut-être l’un et l’autre à la fois ? Peut-être aucun des deux. Ai-je créé les hommes ou les hommes m’ont-ils créé ?
L’unique instinct conféré aux anges, c’est l’instinct de compassion. Une compassion infinie, lourde comme le firmament.
S’en retournant vers le château Mr Popielski passa devant l’église, se décida à y entrer, aperçut l’icône de la Vierge de Jezkotle, mais aucun Dieu capable de rendre l’espoir au châtelain n’était présent.
Quant à la Vierge de Jeszkotle, elle s’efforce d’exaucer les prières de tous ceux qui s’adressent à elle mais elle a beau ressentir une miséricorde infinie envers l’humanité, elle ne peut rien si celle-ci a cessé de croire au miracle.
Au fond, ce que nous dit ce roman, c’est que les dieux sont morts et que les humains sont abandonnés à eux-mêmes, dans une déréliction absolue. Et si certains êtres humains ont un pouvoir tout en conservant leur humanité, ce sont souvent ceux qui sont mis au ban de la société. Ainsi, la Glaneuse qui accouche toute seule d’un enfant mort, dans la forêt,au cours d'une scène hallucinante, est celle qui soigne, celle qui fait corps avec la nature et en tire sa force. Elle devient capable de voir au-delà de la réalité. Capable de concevoir Dieu non comme immuable mais comme celui « qui se manifeste dans le flux du temps ».
Il faut rouler son regard vers tout ce qui se modifie et se meut, vers ce qui déborde des formes, ce qui ondoie et disparaît : la surface de la mer, les danses du disque solaire, les tremblements de terre, la dérive des continents, la fonte des neiges, et les pérégrinations des icebergs, les fleuves qui coulent vers l’océan, la germination des semences, le vent qui sculpte les montagnes, la maturation du foetus dans le ventre maternel, la décomposition des cadavres dans les tombeaux, le vieillissement des vins, les champignons qui poussent après la pluie.
Isidor considéré comme un idiot malgré un esprit toujours en alerte, une conscience tourmentée, représente l’enfance naïve, pure et innocente. C’est le russe Ivan Moukta, matérialiste, qui lui retire ses illusions et lui fait voir un monde sans Dieu, et l’animalité dans la sexualité. Il tue ainsi l’enfance en lui, le laissant désespérément chercher un sens à la vie. Isidor finit par remplacer Dieux par des chiffres : Le temps des quadruplets. Tout est quatre dans la Nature.
Le châtelain Popielski, oscille entre trouver un sens à la vie et se laisser submerger par son non-sens mais c’est le temps qui provoque cette remise en question chez lui, le passage à l’homme mûr, autrement dit l'usure de la jeunesse.
A force de manifester sa puissance, la jeunesse se fatigue. Une nuit, un matin, l’homme franchit la ligne de démarcation, atteint son sommet, esquisse le premier pas de la descente. Survient la question : faut-il descendre fièrement, défier le crépuscule, ou bien tourner son visage vers le passé, s’efforçant de sauver les apparences, prétendre que cette pénombre résulte simplement du fait qu’on a provisoirement éteint la lumière dans la chambre?
Si je devais définir ce roman en quelques mots, je dirai qu’il est très riche (je ne vous ai rendu compte que d’une petite partie de l’oeuvre), douloureux et profondément humain. C’est aussi une réflexion philosophique sur le Temps, la vie et la mort et il nous donne à ressentir une gamme infinie d’émotions. Il correspond aussi à beaucoup de questionnements que l’on se fait quand on atteint un certain âge ou plutôt un âge certain ! Un coup de coeur.
Le temps du moulin à café : de la supériorité des choses
Et si la matière était la seule à pouvoir tenir tête au Temps ? Michel ramène de la guerre un moulin à café qui devient celui de sa fille Misia.
Les gens croient vivre plus intensément que les animaux, les plantes et - à plus forte raison - les choses. Les animaux pressentent que leur vie est plus intense que celle des plantes et des choses. Les plantes rêvent qu’elles vivent plus intensément que les choses. Les choses cependant durent; et cette durée relève plus de la vie que qui que soit d’autre.
A la fin du roman la fille de Misia, Adelka, longtemps après la disparition de son grand père, emporte le moulin avec elle en quittant définitivement la maison familiale. Elle s’installe dans le car :
Elle ouvrit la valise et sortit le moulin à café. Lentement, elle se mit à tourner la manivelle. Dans son rétroviseur, le chauffeur lui jeta un regard étonné.
Peut-être, s’interroge Olga Tokarczuk, nul ne connaît la signification générale d’un moulin. Ils sont là pour moudre. Mais seulement ?
Peut-être le moulin est-il un débris de quelque loi fondamentale de la transformation, une loi dont ce monde-ci ne pourrait se passer sans être tout à fait différent ? Peut-être les moulins à café sont-ils l’axe de la réalité, le pilier autour duquel tout gravite et se développe? Peut-être sont-ils plus importants que le monde des humains ? Peut-être le moulin à café de Misia constitue le pilier central de ce qui se nomme Antan.