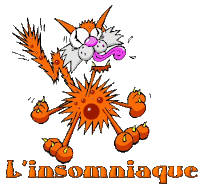Helen Oyeyemi
Née en 1984, Helen Oyeyemi a grandi à Londres et vit aujourd'hui à Prague. Jeune auteur prodige, elle a écrit son premier livre à dix-neuf ans. Le blanc va aux sorcières, son troisième roman, a paru aux éditions Galaade en septembre 2011. Récompensée par le prix Somerset Maugham et acclamée en France comme à l’étranger par la presse, elle est considérée comme l’une des dix artistes qui comptent au Royaume-Uni, et fait partie de la liste 2013 des meilleurs jeunes espoirs de la littérature britannique établie par la revue Granta. (source)
Boy, Snow, Bird est une belle surprise, une plongée dans un monde romanesque à part, qui s’éloigne de ce qui est attendu, qui emprunte au conte de fée traditionnel tout en étant profondément ancré dans la réalité, un mélange d’irrationalité et de poésie nous questionnant sur l’identité, la couleur, le genre.
Nous sommes aux Etats-Unis, dans les années 1930 marquées par la ségrégation et la haine des noirs. Les questions se pressent : Qui est la mère de Boy, un des trois personnages féminins qui donnent son titre au roman? Est-ce elle qui lui a choisi ce prénom, Boy, comme cadeau de naissance, don venimeux d'une sorcière penchée sur le berceau du bébé? La fillette ne l’a jamais connue, elle est élevée par un preneur de rats, géniteur violent et haineux, qu’elle est obligée de fuir. Elle se réfugie dans un petite ville du Massachussets et épouse Arturo Whitmann un bijoutier. Mais à la différence du conte, le mariage n'est pas le happy end attendu pour la jeune héroïne car un enfant naît de cette union. Mais pourquoi Bird, la fille de la blanche et blonde Boy et d'Arturo, est-elle noire?
Nous sommes dans un pays de conte où les frontières se brouillent, où nous perdons tout repère, où les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être, où le blanc apparaît noir, et dans un pays bien réel où le noir est considéré comme laid. Les deux univers se rejoignent dans leur cruauté. L'intelligence de Helen Oyyemi, c'est d'avoir détourné le conte de Blanche Neige pour parler du racisme et de l'intolérable souffrance de ceux qui le subissent.
Nous sommes dans un pays de conte où les frontières se brouillent, où nous perdons tout repère, où les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être, où le blanc apparaît noir, et dans un pays bien réel où le noir est considéré comme laid. Les deux univers se rejoignent dans leur cruauté. L'intelligence de Helen Oyyemi, c'est d'avoir détourné le conte de Blanche Neige pour parler du racisme et de l'intolérable souffrance de ceux qui le subissent.
L’écrivaine brouille habilement les pistes. Le conte traditionnel épouse si étroitement la réalité que l’on ne peut remettre en question la crédibilité de l’histoire : Le preneur de rats ( nous dirions de nos jours, dératiseur) n’évoque-t-il pas le joueur de flûte d’Hamelin? Et qu’en est-il de Snow, la fille d’un premier mariage d’Arturo, si belle avec sa peau blanche et ses cheveux si noirs? et de sa marâtre Boy? Blanche Neige!
Helen Oyeyemi introduit le thème récurrent du miroir qui unit les trois femmes : Boy, Snow et Bird, interrogation sur une identité qui repose sur le mensonge, interrogation aussi sur le Bien et le Mal. Nous ne sommes pas ce que nous paraissons car les miroirs ne sont pas fiables. Boy est la narratrice de la première et dernière partie et Bird prend le relais en deuxième partie. Changement de point de vue qui permet l’effet miroir réfléchissant à l’infini une multitude d’images. Que se cache-t-il derrière la beauté de Snow ? La gentillesse ou une subtile cruauté? Et Boy, est-elle méchante et vicieuse comme l'affirme le preneur de rats? De même Olivia Whitman, la mère d’Arturo, est une femme de caractère, terrible dans sa détermination à paraître ce qu’elle n’est pas, peut-être par haine d’elle-même, et à écarter ce qui se met sur son chemin.
Helen Oyeyemi introduit le thème récurrent du miroir qui unit les trois femmes : Boy, Snow et Bird, interrogation sur une identité qui repose sur le mensonge, interrogation aussi sur le Bien et le Mal. Nous ne sommes pas ce que nous paraissons car les miroirs ne sont pas fiables. Boy est la narratrice de la première et dernière partie et Bird prend le relais en deuxième partie. Changement de point de vue qui permet l’effet miroir réfléchissant à l’infini une multitude d’images. Que se cache-t-il derrière la beauté de Snow ? La gentillesse ou une subtile cruauté? Et Boy, est-elle méchante et vicieuse comme l'affirme le preneur de rats? De même Olivia Whitman, la mère d’Arturo, est une femme de caractère, terrible dans sa détermination à paraître ce qu’elle n’est pas, peut-être par haine d’elle-même, et à écarter ce qui se met sur son chemin.
Si certains passages m’ont paru moins soutenus quelque fois, cela n’a été qu’un ressenti passager car le récit est souvent extrêmement fort comme le sont aussi les personnages. Le preneur de rats, surtout, est terrifiant et envoûtant, dès qu’il apparaît. j’ai beaucoup aimé aussi la lettre de Charlie, un amoureux éconduit de Boy, sur sa tante Jozsa, qui refuse de renier ses idéaux; ou encore l’affrontement de Boy et de sa belle mère Olivia après la naissance du bébé, ce qui aboutit au récit de la vieille dame sur sa jeunesse. Mais je ne vais pas tout vous raconter et je vous laisse découvrir ce livre que j’ai beaucoup aimé.
Personne ne m'avait jamais prévenu au sujet des miroirs, de sorte que je les ai appréciés durant longtemps, les croyant fiables. Je me cachais entre eux en en plaçant deux face à face de sorte que, debout au milieu, j'étais réfléchie à l'infini dans l'un ou l'autre sens. Beaucoup, beaucoup de moi. Quand je me dressais sur la pointe des pieds nous étions toutes dressées sur la pointe des pieds, à tâcher de voir la première d'entre nous, et la dernière. L'effet était vertigineux, une immense pulsation, pas tout à fait vivante, tenant plus du fonctionnement de l'automate. Je ressentais le reflet sur mon épaule comme un tapotement. j'étais avec lui dans les termes les plus intimes, comme n'importe quelle petite nouille trop seule pour être difficile avec ces fréquentations.
Merci à Dialogues croisés et aux éditions Galaade