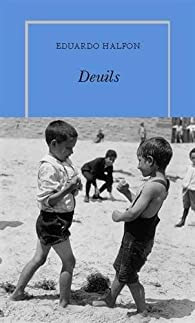Nous sommes à Mancherster en 1839. La révolution industrielle avec le développement des métiers à tisser entraîne une raréfaction du travail et des salaires misérables pour les ouvriers des filatures. La pauvreté qui régnait déjà dans ces milieux se transforme alors en une misère intolérable : plus de pain, plus de bois pour chauffer les taudis insalubres où s’entassent ces misérables. Ceux-ci meurent de faim ou de froid; ils sont décimés par les privations et la maladie; une épidémie de typhus se propage. La colère exacerbée par les souffrances et les deuils gronde parmi les travailleurs et le fossé s’agrandit encore entre la classe dirigeante et les ouvriers.
John Barton, ouvrier syndicaliste, un des personnages principaux du roman, se radicalise comme la plupart de ses amis.
Dans ce contexte menaçant, la fille de John, Mary Barton, une jolie couturière, est courtisée par le fils du patron, le séduisant Harry Carson. La jeune fille, coquette et naïve, est sensible à ses avances et rêve de pouvoir sortir de la misère en faisant un beau mariage. Mais son ami d’enfance Jem Wilson, ouvrier, fils du meilleur ami de son père, fou d’amour pour elle, la demande en mariage. Qui va-t-elle choisir ? Mary, toute jeune encore, n’est pas très lucide sur ses sentiments. Elle ne peut savoir que cette hésitation va provoquer un terrible drame dans une situation tendue où tout peut exploser..
La lutte des classes
 |
| Elizabeth Gaskell de William John Thompson |
Mary Barton est le premier roman de E. Gaskell. Dès ce premier livre, Elizabeth Gaskell a une maîtrise de l’écriture qui se manifeste par une description précise, documentée, réaliste de la vie des ouvriers, des rapports avec leurs patrons et des luttes syndicales. Le roman paru en 1848 sous un nom d’emprunt a fait scandale lorsque l’on sut que c’était une femme qui l’avait écrit.
Manifestement, Elizabeth Gaskell connaît bien les problèmes des milieux populaires. Elle a vécu, chez ses parents, dans une sphère intellectuelle qui s’intéresse à la politique et au sort du peuple. Quand elle va s’installer à Manchester pour suivre son mari, pasteur, en 1832, elle découvre les quartiers sordides où habitent les ouvriers des filatures de coton. Elle se rend compte qu’ils manquent de tout. En se liant avec certains d’entre eux, elle prend conscience de la colère et de la rancoeur qu’ils éprouvent envers les riches qui profitent de leur travail pour augmenter leur fortune mais les laissent dans la précarité et le dénuement.
Le but d’Elizabeth Gaskell n’est pas révolutionnaire. Elle essaie de ne juger ni les uns, ni les autres, Mais on sent bien sa compassion envers les humbles. Ce qu’elle cherche à faire comprendre aux employeurs comme aux employés, c’est que leurs intérêts sont communs.
« qu’il fût admis que les intérêts des uns étaient ceux de tous, et comme tels, qu’ils fussent envisagés et discutés par tous; qu’en conséquence, il était souhaitable que les ouvriers ne fussent pas seulement ignorants se comportant comme des machines, mais des hommes éduqués, capables de discernement; et qu’il existent entre eux et leurs patrons des liens de respect et d’affection »
Les patrons aussi souffrent de la révolution industrielle et chaque classe devrait consentir à des sacrifices en temps de crise (même si, comme E Gaskell le fait remarquer, les uns sont privés du superflu, les autres de l’essentiel) mais tous devraient pouvoir profiter de la prospérité ensuite. Un discours que je crois avoir entendu à notre époque, non?
« Ces machines dernier cri ont transformé la vie des hommes en loterie. Et pourtant, je suis persuadé que les métiers mécaniques, comme les trains et toutes ces inventions modernes sont des dons de Dieu. J’ai vécu assez longtemps pour voir que ça fait partie de son plan de nous envoyer des souffrances et qu’au bout du compte il en sort du bien; mais sûrement, ça fait aussi partie de son plan que le poids de ces souffrances soit allégé autant que faire se peut par ceux qu’il a eu la bonté de rendre heureux et satisfait de leur sort ici-bas. »
Très moderne donc, la conception d’Elizabeth Gaskell quand elle envisage une prise de conscience des deux parties à propos de leurs intérêts communs et des rapports de classe!
Par contre, elle l’est moins et c’est bien compréhensible au XIX siècle - n’oublions pas qu’elle est aussi femme de pasteur - quand elle envisage les différences de classe sociale comme une volonté divine et qu’elle laisse la solution à la miséricorde des patrons ! Il est vrai qu’à côté des oboles et de la charité privée, elle demande, dans sa préface, au gouvernement une législation d’urgence pour éviter le pire. Elle écrit en 1848, le spectre de la révolution française est devant ses yeux, et elle a le sentiment que les ouvriers du textile sont laissés dans un état « où les lèvres se crispent sur des malédictions et où les poings se serrent prêts à frapper. »
La peinture des ouvriers
 |
| Révolution industrielle : métiers à tisser |
Ne pensez pas pourtant que la description de ces luttes sociales est un pensum. E Gaskell a le don de faire vivre ses personnages, de nous faire partager leur malheur en les peignant dans leur intérieur, ces petites maisons grises, sales et sans confort ou bien, pour les plus démunis, ces caves humides - qui rappellent celles de Victor Hugo - où l’on meurt sans voir la clarté du jour. De plus, elle connaît si bien ce milieu qu'elle a des accents d'une grande authenticité, ce qui fait d'elle un admirable témoin de la société de son temps.
Après ma description de l’état de la rue, personne ne sera surpris si je dis qu’en entrant dans la cave où habitaient les Davenport, les deux hommes furent saisis par une odeur si fétide qu’ils faillirent suffoquer. Ils se ressaisirent rapidement, comme tous ceux qui sont habitués à ces choses-là et, s’accoutumant à l’épaisse obscurité, ils distinguèrent trois ou quatre jeunes enfants qui rampaient à même le sol de brique humide, que dis-je, trempé, à travers lequel suintaient les liquides infects de la rue. L’âtre était vide et noir; la femme assise à la place de son mari, pleurait dans la solitude sombre.
Pour Gaskell les ouvriers ont une grandeur certaine, les uns par leur dignité face à la faim et aux privations, les autres par leur esprit de solidarité qui les pousse à donner leur pain à plus pauvre qu’eux. Leur morale est exigeante. Et même lorsqu’ils se laissent aller à des idées extrémistes et violentes, Gaskell ne les excuse pas mais elle les comprend.
En effet, comme George Sand, Elizabeth Gaskell a une haute idée du peuple. L’auteure nous montre le désir d’apprendre de certains d’entre eux. Même ignorants, ils sont intelligents et comblent leur lacune par l’intelligence du coeur; évidemment l’écrivaine salue, en particulier, ceux qui sont religieux et savent conserver leur foi. On sent le respect qu’elle éprouve pour un certain type d’homme du peuple, personnes réelles qu’elle a rencontrées et appréciées.
Quant au lecteur, il s’attache aux personnages principaux comme Mary sincère et si courageuse et aussi à Margaret la petite chanteuse aveugle, à son grand père, un savant qui se passionne pour l’entomologie et tant d'autres… Elle nous fait partager leurs joies et leurs chagrins.
De plus la traductrice française, Françoise du Sorbier, est parvenu à rendre au plus près la différence sociale entre les deux classes en conservant deux niveaux de langage en français, ce qui rend les dialogues authentiques. En effet, les ouvriers de E. Gaskell parlent le dialecte du Lancashire, qui est celui d’une classe issue de la campagne gagnée par l’exode rural au moment de l’industrialisation.
Une histoire d’amour et un roman initiatique
Mary Barton est aussi un livre initiatique, celle d’une très jeune fille qui donne son titre au roman; elle a seulement treize ans au début du récit. Orpheline de mère, elle n’a pas de guide pour la protéger. Elle ne sait pas ce qu’est l’amour et le découvrira peu à peu. Ses erreurs sont dues à son inexpérience, sa naïveté, son ignorance des classes sociales. Certes, elle est coquette et tire un peu vanité de sa beauté, mais elle est sincère en amitié comme en amour, et elle ne se laisse jamais aller devant l’adversité. Face aux difficultés et mise au pied du mur, elle ne baisse pas les bras et se montre volontaire, intrépide et courageuse. C’est finalement une héroïne très positive.
Un art du suspense
 |
| Mary Barton au tribunal |
A partir du moment ou une menace pèse sur l’amoureux de Mary et où elle va tout mettre en oeuvre pour lui venir en aide (je ne veux pas vous en dire plus pour ne pas dévoiler l’intrigue), Elizabeth Gaskell a un art certain pour jouer sur les nerfs et maintenir le lecteur dans l’urgence. Nous sommes donc suspendus à l’action, angoissés. Le temps est compté et rythme les déplacements de la jeune fille. Une course contre la montre s’engage pour le salut de son bien-aimé. Nous craignons le pire même si nous savons que Elizabeth Gaskell n’est pas aussi cruelle envers ses personnages que Thomas Hardy ! Et c’est sûr que l’auteur de Jude l’Obscur, n'aurait pas imaginé un dénouement aussi indulgent pour le couple d'amoureux !
Elizabeth Gaskell pense que l’amour, la foi et le dialogue sont de puissants leviers pour remédier aux maux de l’humanité. Mais elle est consciente que les temps ne sont pas encore venus de cette réconciliation entre employeurs et employés. C’est la limite de son optimisme, c’est pourquoi pour survivre, le couple sera obligé de s’exiler. Elle épargne ainsi ses jeunes gens en leur laissant un espoir.
Un très bon roman donc qui a été mal accueilli à Manchester où les administrés de son mari pasteur, ne lui adressèrent plus la parole. Cependant l'écrivaine suscite l’admiration de Charles Dickens et de Carlyle et est reçue dans les cercles littéraires londoniens. Sa renommée dépasse bientôt le cadre national. Dostoievsky lui-même fait une traduction de Mary Barton en Russe. En 1907 son oeuvre est interdite dans les écoles en Angleterre. Elle ne fut redécouverte en Angleterre qu’en 1970. L’oeuvre a été depuis adaptée au cinéma, au théâtre et à la télévision.